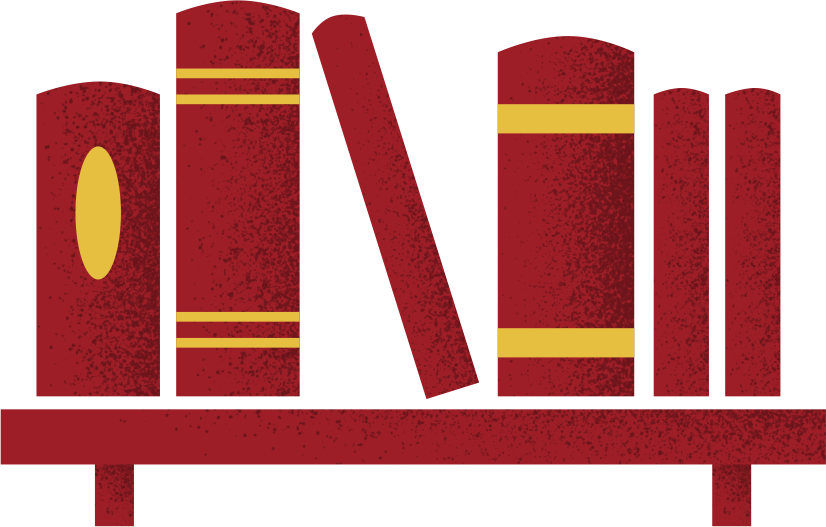Vincent Duclert, historien spécialiste des génocides et des processus génocidaires

Vincent Duclert, né le 26 février 1961 à Neuilly-sur-Seine, est un historien, enseignant-chercheur, et inspecteur général de l’Éducation nationale[1]. Il est spécialiste des génocides et des processus génocidaires. Il s’est particulièrement intéressé au génocide des Arméniens, au génocide des Tutsis au Rwanda, ainsi qu’à l’affaire Dreyfus. De 2019 à 2021 il préside la Commission française d’historiens sur le rôle de la France au Rwanda, à la demande du président de la République Emmanuel Macron.
L’historien et le génocide des Arméniens
L’arrivée d’un historien de la IIIe République en France et des sociétés démocratiques sur l’histoire du génocide perpétré contre les Arméniens de l’Empire ottoman résulte d’une démarche aussi bien personnelle, qu’universitaire et scientifique, débutée à la fin des années 1990 et qui n’a pas cessé depuis, qui s’est renforcée au fil des années face aux événements. La cohérence entre les trois domaines signalés est par ailleurs interrogée et validée. Cette arrivée sur le sujet a pris la forme de différentes publications mais aussi de coresponsabilités, de colloques internationaux et d’animation de la recherche, débouchant sur les présidences d’une Mission d’étude sur la recherche et l’enseignement des génocides et des crimes de masse (2016-2018) puis d’une Commission de recherche (2019-2021). Relativement aux publications, celles-ci relèvent d’une série d’articles de nature scientifiques et d’écrits de vulgarisation sur l’historiographie et l’histoire, mais aussi de recherches de plus grande ampleur par des ouvrages en nom propre ou collectif. En 2015 paraît une étude globale des réponses françaises au génocide des Arméniens saisies dans leur pluralité, leurs expressions et leur longue durée, du milieu du XIXe siècle à nos jours : La France face au génocide des Arméniens, du milieu du XIXe siècle à nos jours[2]. Elle se destine aussi à former le mémoire principal d’une habilitation à diriger des recherches. Le rapport de synthèse de l’HDR explicite l’objectif de cette recherche[3]. Il s’agit tout à la fois d’établir un savoir neuf sur un sujet qui, malgré la recherche accumulée, ne bénéficie pas d’un intérêt scientifique soutenu, et de permettre la transmission de cette connaissance de manière à favoriser la reconnaissance publique d’une histoire des génocides. La publication de cette recherche doit en conséquence participer au rôle des savoirs dans la construction des sociétés démocratiques. Cette dimension de la transmission publique, de l’information nécessaire est centrale à notre approche de la constitution des intellectuels et des engagements sociaux. Elle est partie prenante du lien entre pratiques de savoir et conscience de citoyenneté, point central de notre thèse de doctorat d’histoire sur l’engagement des savants dans l’affaire Dreyfus soutenu en 2009[4]. Une brève élucidation de ce dossier est nécessaire pour comprendre mon arrivée sur le génocide des Arméniens.
La thèse de doctorat mentionné étudie une composante centrale de la naissance des intellectuels communément admise dans l’affaire Dreyfus. Cette recherche aboutit à démontrer le rôle central des savants et des savoirs dans l’élargissement de la politique moderne à des acteurs non-politiques définis par ce terme d’« intellectuels » – lequel a été forgé en relation, précisément, avec cet engagement émanant des élites scientifiques. L’intervention des savants dreyfusards dans une affaire désertée par les élites politiques visaient à restaurer (ou à instaurer) un fonctionnement démocratique du régime républicain en ramenant dans le champ politique des valeurs de type moral, justice, vérité, liberté à laquelle les savants accordaient, professionnellement, du prix. L’engagement des savants relève d’un combat de nature démocratique, qui est affirmé comme tel, et qui permet de constater l’importance des savants dreyfusards dans la formation de l’intellectuel démocratique au XXe siècle. Il est en effet singulier que l’affaire Dreyfus, intervenue à la fin du XIXe siècle dans un monde qui n’était pas encore celui du XXe siècle, a perduré comme événement au point de rester très contemporaine. Les engagements dreyfusards des savants auraient paru comme inadéquates à l’« ère des tyrannies » pour reprendre l’expression de l’historien et philosophe Elie Halévy forgée en 1936 pour qualifier la rupture d’avec l’avant-1914 ; tyrannies indissociables des formes d’État total qui conditionnent la réalisation d’une extermination à caractère génocidaire. En réalité, la matrice de ces engagements et l’intellectuel démocratique qui en était le produit se révélèrent efficaces et pertinents dans le combat antitotalitaire et la résistance à l’occupation nazie. Définissant devant la Société française de philosophie, lors de la conférence dite de « l’ère des tyrannies » du 28 novembre 1936, les menaces considérables qui pesaient désormais sur l’Europe libérale, il se reportait près de quarante ans en arrière, invoquant l’héritage de l’affaire Dreyfus[5].
Précédant de quelques mois le combat dans l’affaire Dreyfus, les mêmes intellectuels, qui n’en avaient pas encore le nom mais qui déjà agissaient, s’étaient engagés pour les Arméniens de l’Empire ottoman victimes en masse des grands massacres décrétés par le sultan Abdülhamid II entre 1894 et 1896, aboutissant une hécatombe de près de 200 000 morts et des provinces arméniennes dévastées à jamais. La mobilisation des intellectuels pour les Arméniens de l’Empire ottoman représente une forme de répétition générale de la bataille pour le capitaine Dreyfus. Cet engagement d’humanité est assumé comme tel, de Jean Jaurès à Georges Clemenceau, de Victor Bérard à Pierre Quillard, d’Anatole France à Charles Péguy, comme son lien avec l’Affaire une fois que celle-ci éclate. C’est le même combat contre la violence de l’État, le mensonge organisé et le viol des droits humains. C’est ainsi que de l’affaire Dreyfus, nous sommes arrivés au génocide des Arméniens. Puissant intellectuellement, français, européen et même mondial, le « parti arménophile » échoue cependant à façonner un large mouvement d’opinion publique en France et en Europe et à imposer aux responsables politiques un devoir d’intervention pour sauver les Arméniens[6]. Il ne peut conjurer la banalisation de l’inconcevable, une « guerre d’extermination » selon Jean Jaurès en 1896[7], le « meurtre d’une nation » selon l’historien britannique Arnold Toynbee en 1916[8]. Du moins les intellectuels engagés dans le combat pro-arménien ont-ils fixé des barrières morales et défini le pouvoir de la raison critique. Ils n’ont pas échoué à cet égard, à commencer par la possibilité qui est donnée d’écrire l’histoire d’un tel engagement et de sa persistance jusqu’à nos jours à travers des mémoires d’acteur comme celle de Jean Jaurès, ou des attitudes d’historien comme celle de Pierre Vidal-Naquet : les travaux de ce dernier, ses combats de connaissance font le lien entre deux événements historiques qui interrogent profondément, bien que différemment, les pouvoirs de la recherche, l’affaire Dreyfus, le génocide des Arméniens. L’un s’achève par une relative victoire de l’humanité, l’autre par une défaite sans nom.
La France face au génocide des Arméniens obéit, en 2015, à ce double objectif de production et de transmission de la recherche. En dépit des contraintes de calendrier inhérentes à la commémoration du centenaire du génocide des Arméniens, le manuscrit arrive à bon port, lesté d’un appareil de citations restituant les écrits, discours et déclarations de combat en faveur des Arméniens : ceux-ci constituent les armes principales des engagements intellectuels menés contre la politique d’extermination d’un peuple et son abandon par les puissances européennes. Redonner vie à ces textes c’est aussi entrer en profondeur dans les engagements étudiés. Rendre publique, c’est attester d’une réalité pour mieux s’y opposer, la combattre en la révélant. Cet objectif ne peut cependant se réaliser que dans un cadre de démocratie d’opinion. La lutte contre les phénomènes génocidaires consiste par conséquent en un engagement pour l’extension de la démocratie. Et tout combat en faveur de la liberté d’expression aide à repousser les processus de génocide. L’étude du cas arménien le démontre, particulièrement pour ses prolégomènes en 1894-1896.
Cette recherche sur le premier génocide est aussi le résultat d’un long cheminement sans la connaissance des génocides avec d’autres historiens impliqués dans cette réflexion, Hamit Bozarslan, Raymond H. Kévorkian, Anahide Ter Minassian (†), pour le génocide des Arméniens, Stéphane Audoin-Rouzeau, Hélène Dumas, José Kagabo (†), pour le génocide des Tutsis du Rwanda, Marc Olivier Baruch, Henry Rousso, Annette Becker, pour le génocide des Juifs d’Europe. Cette élaboration commune est permise notamment grâce aux milieux de recherche déployés à l’Ecole des hautes études en sciences sociales. Elle intègre une forte dimension historiographique et méthodologique dont témoigne l’article publié dans la revue Vingtième siècle. Revue d’histoire en 2004 : « Les historiens et la destruction des Arméniens[9] ». Le travail conduit sur le fait génocidaire, interrogé dans ses origines, est mis à l’épreuve d’un séminaire de l’EHESS créé avec Mikael Nichanian en 2014. Notre entrée à l’Inspection générale de l’éducation nationale, l’année précédente, en avril 2013, ne nous éloigne de la recherche en général et de ce terrain du génocide des Arméniens en particulier. En parallèle s’élabore une structure collective créée le 31 janvier 2013, le « Conseil scientifique internationale pour l’étude du génocide des Arméniens » (CSI). Celui-ci devient l’institution organisatrice d’un colloque international pour le centenaire du génocide des Arméniens, se déroulant à Paris du 26 au 29 mars 2015, centré sur l’étude de « cent ans de recherche ».
Néanmoins, le travail mené sur le génocide des Arméniens ne vise pas seulement à confirmer des hypothèses sur la France républicaine et la naissance des « intellectuels ». Déjà, dans notre contribution au livre Comprendre le génocide des Arméniens co-écrit en 2014 avec Hamit Bozarslan et Raymond H. Kévorkian, nous avions élargi l’enquête aux réponses internationales sans se limiter donc à celle de la France. Elle inclut le rapport de la Turquie et des citoyens de Turquie à leur histoire, un sujet capital pour comprendre le négationnisme et la pathologie qu’il implique pour toute une société contrainte d’adhérer à un mensonge national. En l’obligeant à une telle violence, le pouvoir d’Etat l’institue en complice du génocide lui-même et l’empêche de se libérer de cette pathologie. Ce système de domination, dans le cadre d’un Etat-nation moderne, est loin d’être unique dans le monde mais il est mené à un stade particulièrement avancé en Turquie. Il requiert une histoire critique débutée lors d’une expérience de terrain de plus de deux ans, principalement à Istanbul où nous avons effectué notre service militaire au sein des services français de coopération, entre 1986 et 1988, comme attaché linguistique et lecteur dans trois universités de la ville.
Cette connaissance de la Turquie, du moins celle des grandes métropoles qu’étaient à l’époque Istanbul, Izmir et Ankara, nous a livré un certain nombre de clefs historiques, intellectuelles et sociologiques. Elle nous a aussi dirigé vers des recherches sur la Turquie comprise avant même sa naissance, avec le mouvement national lancé par le général Mustafa Kemal dès 1919. Celles-ci ont débuté par des travaux de synthèse, à l’invitation de Jean-Jacques Becker auquel nous devons beaucoup, dans le cadre d’une Encyclopédie de la Grande Guerre qu’il avait dirigée avec Stéphane Audoin-Rouzeau. L’article commandé sur la Turquie fut transformé en quatre contributions en raison de la complexité et de l’importance du sujet : « L’Empire ottoman dans la guerre », « Le génocide des Arméniens » et « la Turquie après la guerre »[10], et, s’y ajoutant, l’étude sur l’historiographie du premier génocide déjà mentionnée. En 2006, il nous a été demandé, dans une perspective assez similaire, de rédiger de nouvelles contributions pour l’histoire collective de la guerre et de la reconstruction dirigée aux Etats-Unis par Jay Winter et John Merriman[11].
Il importe ici de souligner que l’ouverture du chantier consacré au génocide des Arméniens s’est faite en relation avec l’étude de la Turquie contemporaine, des courants démocratiques au sein de la société et des combats intellectuels, scientifiques pour la reconnaissance d’un passé interdit. Nous avons observé de près la manière dont le génocide des Arméniens a pu, un moment donné, acquérir un droit de cité et comment cette question est devenue un enjeu majeur de démocratisation parce qu’elle met en question un négationnisme comme outil d’un contrôle totalitaire d’une société, d’une vie publique, privée et même intime. Le négationnisme n’opère pas seulement sur le génocide en le faisant disparaître de l’horizon public et privé des Turcs mais qui représente aussi un procédé totalisant de modélisation de la société à qui est imposé un système d’éradication du passé, de soumission à une idéologie de la négation et d’assignation à l’obéissance. Le négationnisme fonctionne comme un dispositif de coercition politique, social et mental très abouti, qui vise un conditionnement généralisé d’une société à la peur, au silence et à l’oubli. Ceci a été mis en lumière par la chercheuse et journaliste Ece Temelkuran lors d’une journée d’étude à l’Institut français d’études anatoliennes d’Istanbul le 6 mars 2015[12]. Aussi, en Turquie, le travail de la recherche sur le génocide prend-il un relief particulier puisqu’il exige en même temps de constituer scientifiquement l’objet et de défier le négationniste d’Etat. En dix ans, depuis la conférence des 24 et 25 septembre 2005[13] sur le sort des Arméniens ottoman à la veille de la Première Guerre mondiale, où le mot et le concept de génocide ont été largement utilisés, l’historiographie turque a non seulement intégré la dimension du génocide, mais aussi retrouvé dans l’histoire sociale, économique, intellectuelle, culturelle, religieuse, militaire, tous les champs historiens en définitive, le monde arménien disparu de l’Asie Mineure entre 1915 et 1923, sans lequel il n’est pas possible d’écrire sur la Turquie[14]. Ce moment historiographe s’est achevé, brutalement brisé par la répression politique du régime du président Erdogan après 2015. Elle a visé tout particulièrement les chercheurs et historiens de Turquie et elle se poursuit, criminalisant les libertés académiques comme les initiatives intellectuelles et les mouvements sociaux. La peur instillée à toute la société, l’autocensure et le conditionnement des esprits sont l’objectif du pouvoir. Et portant beaucoup de Turques et de Turcs résistent, prenant des risques insensés pour la défense de la liberté.
Ce lien entre l’étude du génocide des Arméniens et l’histoire politique de la Turquie, entre l’investissement dans la connaissance et la démocratisation d’une société, entre un objet historique rejeté et le progrès de la recherche avait été posé dès la fin du XIXe siècle par les savants, historiens, philosophes, écrivains, … engagés contre les grands massacres hamidiens. Dans son offensive parlementaire du 3 novembre 1896, Jean Jaurès insiste bien sur la réponse à apporter à ce déchainement de violence contre les Arméniens, celle d’un progrès des libertés dans l’Empire ottoman et un soutien aux démocrates de Constantinople. Je me suis efforcé de documenter et d’étudier cet engagement jaurésien à la suite des premiers travaux de Madeleine Rebérioux et de Gilles Candar. La publication de l’anthologie des discours de Jaurès en 1896 et 1897[15] s’est accompagnée d’une étude sur « la fêlure des massacres arméniens »[16] et une présentation, au cours d’un colloque de l’université Sabancı à Istanbul en 2009, des limites de cet engagement lors des massacres d’Adana à l’instigation du nouveau gouvernement des Jeunes-Turcs réputé progressiste à torts. La capacité d’un Etat-nation moderne d’engager des processus de destruction plus radicaux encore que dans le cadre d’une monarchie impériale tenue pour archaïque et malade, et l’incompréhension des contemporains sur ce type de risques, sont une question historiographique majeure. Celle-ci a nourri notamment une forte controverse autour de l’ouvrage de François Furet sur Le Passé d’une illusion au lendemain de sa publication en 1995. Cette question prend un sens particulier dans notre parcours scientifique en raison du travail inaugural commencé à cette même date, 1995, sur l’œuvre d’Elie Halévy – lequel s’est approché très tôt, et de très près, de cette dimension totalitaire des tyrannies modernes[17]. Aujourd’hui, la moitié du programme d’édition de ses œuvres complètes a été réalisée et une nouvelle édition de l’Ère des tyrannies a vu le jour il y a quelques mois, toujours aux éditions des Belles Lettres[18].
De différents côtés, ce dossier sur le génocide des Arméniens et la relation tissée par une nation complexe qu’est la France se rattache à nos travaux, qu’ils portent sur l’affaire Dreyfus et la naissance des « intellectuels », sur la définition d’un pays entre des logiques d’Etat, une dimension de politique impériale et des traditions morales, sur les questions historiographiques émanant de l’enquête, des archives, de la documentation et de la mémoire, sur la responsabilité des chercheurs devant l’inconcevable, devant la guerre étendue jusqu’aux frontières de l’inhumanité, devant la mise en œuvre d’une persécution jusqu’à l’extermination. C’est bien là que se pose, fondamentalement, le sujet de « l’historien et le génocide des Arméniens ».
En 2015, aux deux ouvrages La France face au génocide des Arméniens et Comprendre le génocide des Arméniens s’ajoute l’édition des actes « Cent de recherche » en tant que coresponsable du colloque international. La décennie suivante voit les travaux sur le génocide des Arméniens s’inscrire davantage encore dans une approche globale des génocides et des processus génocidaires. C’est le sujet d’un cours créé à Science Po, maintenu jusqu’en 2021, et c’est l’objet principal d’une mission d’étude en France sur la recherche et l’enseignement des génocides et des crimes de masse forte de 65 membres. Nous en assumons la présidence durant ses deux années d’activités, entre 2016 et 2018. Elle comprend plusieurs historiennes et historiens du génocide des Arméniens, et la restitution de ses travaux, sous la forme notamment de deux ouvrages collectifs, s’y attachent tout particulièrement par son caractère précurseur et anticipateur[19]. Le 5 avril 2019, une lettre de mission du président de la République nous charge d’une recherche sur le rôle et l’engagement de la France au Rwanda durant le génocide des Tutsis de 1994 et durant la période pré-génocidaire qui précède. Nous réunissons une commission de chercheurs et d’historiens parmi lesquels le spécialiste de premier plan du génocide des Arméniens, Raymond H. Kévorkian[20]. La connaissance du premier génocide nourrit le travail d’enquête et d’analyse qui aboutit à un rapport de 1200 pages, remis le 26 mars 2021 à Emmanuel Macron et aussitôt rendu public avec l’ensemble de ses sources intégralement ouvertes à tout public[21].
À cette date, Raymond H. Kévorkian et nous-même revenons plus frontalement sur le sujet du génocide des Arméniens. Il publie en septembre 2023 le résultat d’une très importante recherche sur le parachèvement du génocide par le mouvement national turc après la fin de la Première Guerre mondiale –laquelle aurait dû mettre un terme à la destruction paroxystique de 1915-1917[22]. Plus modestement, constatant le recours à un acte de génocide par l’État azerbaïdjanais contre les Arméniens du Haut-Karabagh, à savoir la famine imposée à l’ensemble du groupe à partir de décembre 2022, nous faisons paraître au même moment, septembre 2023, un essai sur le temps long du génocide et ses conséquences pour le monde[23]. L’une des pages des conclusions expose qu’aucune fatalité ne pèse sur les génocides bien qu’apparaissant comme les événements historiques les plus terrifiants, comme semblant annihiler toutes capacité de résistance humaine[24].
Le sort des Arméniens est écrit d’avance avant même qu’ils ne vivent, décrété par leurs bourreaux, et cela depuis les grands massacres qui ont déferlé sur les provinces arméniennes de l’Empire ottoman à la fin du XIXe siècle. S’opposer à cette engeance de criminels suppose de croire en la justice comme l’écrivait Charles Péguy en 1898 pour saluer le combat en faveur des Arméniens victimes des grands massacres. Suppose aussi d’agir en mobilisant sa liberté. Franz Werfel, auteur en 1933 du roman historique, Les Quarante jours du Musa Dagh[25], a prouvé qu’un héroïsme de la pensée pouvait défier l’univers des crimes, a composé un récit de résistance mais aussi de liberté. Sa propre liberté est déterminante dans le regard de compassion et de révolte qu’il porte sur ces orphelins arméniens aperçus à Damas. Il agit comme Jaurès, en 1898 toujours, lorsqu’il dit de Dreyfus dégradé à Paris, déporté sur l’île du Diable, « dépouillé, par l’excès même du malheur, de tout caractère de classe, [qu’] il n’est plus que l’humanité elle-même, au plus haut degré de misère et de désespoir qui se puisse imaginer.[26] »
Franz Werfel mobilise une incomparable liberté de pensée pour aborder une réalité que personne n’interroge, et pour en donner une signification de tout premier plan, historique autant que philosophique. Cette liberté de l’écrivain défi le plan concerté de l’oubli, le percute avec la force de l’œuvre et décide de faire entendre le récit de résistance des combattants arméniens. Il raconte la lutte de ceux qui, acculés sur la montagne de Moïse, repoussent les tueurs depuis quarante jours[27]. Epuisés, à court de munitions, ils sont proches de la fin. C’est alors que le commandant d’une escadre franco-anglaise, apercevant les volutes de fumées des feux de détresse allumés sur la plage, décide de lui-même, sans attendre une instruction de l’amirauté, d’aller au secours des combattants. Ses cuirassés ouvrent le feu, l’infanterie de marine est débarquée, les tueurs sont mis en déroute, et les quatre mille Arméniens rescapés du Musa Dagh sont embarqués sur les vaisseaux qui mettent le cap sur Port-Saïd, en Egypte.
L’opération de la marine française décrite par le romancier est véridique, et l’ordre du commandant l’escadre, le vice-amiral Louis Dartige du Fournet, dont le nom est absent du roman, est historique. Le 12 septembre 1915, il déclenche l’unique opération d’intervention contre un génocide, par l’emploi de moyens militaires et l’usage de la force contre les tueurs organisés. L’écrivain imagine même le commandant de l’escadre décidant de se rendre lui-même sur le champ de bataille, malgré les risques certains d’une telle « excursion en terre ennemie[28] ». Mais il faut entendre ce débarquement du vice-amiral comme un salut adressé aux héroïques combattants arméniens. Et aussi comme une démonstration de force à l’intention des assassins : « on envoyait à terre, de tous les navires, des détachements d’infanterie de la marine munie de mitrailleuses[29] ».
La décision prise par l’officier général, si elle témoigne de son intelligence de la situation et de son éthique de la mission, n’en révèle pas moins un immense choix de liberté dans le commandement de l’escadre, un courage dans l’action qui change tout de l’histoire et du sens qu’on choisit de lui donner. La carrière du vice-amiral Louis Dartige du Fournet connaît par la suite de graves vicissitudes qui ne s’expliquent pas uniquement par l’affaire du Musa Dagh. Mais tout de même. L’officier a payé pour sa liberté. Malgré l’hommage que rend Franz Werfel à ce « haut personnage » au « caractère obstiné », l’héroïsme de l’amiral Dartige du Fournet est resté inconnu. Près de cent ans seront nécessaires pour qu’une réhabilitation se dessine. Aujourd’hui, sa famille attend de la Royale qu’un navire porte son nom, juste reconnaissance pour une opération de la marine française à la mesure du théâtre d’extermination qu’elle affronta.
Le combat de la liberté n’est jamais vain. Les Arméniens qui affrontent aujourd’hui le pire de leur existence depuis le génocide de 1915 et le déni de 1923 ont légué au monde cette vérité. Elle nous appartient qui que nous soyons. Si l’Arménie succombe au Caucase, si l’imaginaire qu’elle éveille disparaît en nous, c’en est fini de cette vérité, de cette liberté. Alors, combattons pour elles, pour eux.
Aussitôt après la publication de cet ouvrage Arménie, Raymond H. Kévorkian et nous-même prenons la décision, avec Thomas Hochmann, juriste spécialisé sur le négationnisme, de lui donner une suite. Nous rédigeons alors collectivement une nouvelle étude sur le temps long du génocide des Arméniens, celui-ci interrogé dans son rapport avec la justice démontrant comment celle-ci, sur un plan international particulièrement, s’est affirmée dans le défi de juger 1915. C’est-à-dire le premier génocide dans l’histoire tel qu’il est compris par Raphael Lemkin, le père de la Convention des Nations Unies pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948. Les lignes qui suivent sont empruntés à l’introduction du livre qui paraît en mars 2025[30].
Mobilisant leurs recherches respectives, les trois auteurs s’emploient à constater et détailler, depuis la fin du XIXe siècle jusqu’aux temps présents, un mouvement de reconnaissance juridique, judiciaire et historique, adossé aux échelles nationales comme internationale, par étapes successives, du génocide des Arméniens ottoman par l’État jeune-turc unioniste. Bien que cette catégorie de crime n’existe en droit international (puis national) qu’à partir de 1948 avec la convention des Nations Unies voulue et conçue par Raphael Lemkin, les premières analyses des grands massacres d’Arménie en 1894-1896 soulignent le caractère d’inhumanité des atrocités et introduisent une obligation d’agir par la création d’un droit humanitaire universel. Les premières bases en sont posées dès 1899 par la doctrine dite Martens, du nom du juriste russe qui l’expose à la conférence de la Paix de La Haye. La modernité de ce crime, l’innovation dans sa planification, l’absence de références antérieures, ont en fait été à l’origine du processus de transformation du droit international humanitaire.
Le passage à la phase paroxystique du génocide des Arméniens de l’Empire ottoman en 1915, victimes de l’extermination planifiée et méthodiquement exécutée du pouvoir jeune-turc unioniste, déclenche de nouvelles réponses par le droit et fait se succéder des procès contre les perpétrateurs, bien que pour la plupart d’entre eux ceux-ci soient demeurés inachevés ou tronqués ou encore que les condamnations prononcées le soient par contumace, en l’absence des prévenus, en fuite. Un verdict général n’en ressort pas moins de ces multiples actions, procédures et instructions qui aboutit à une grande avancée du droit comme à la possible instauration d’une justice internationale. Les tentatives répétées du négationnisme turc de détruire ce verdict et d’empêcher les progrès juridiques, comme ceux de la mémoire et de l’histoire, conduisent de rares mais très déterminés juristes, historiens et écrivains à poursuivre dans la voie de la prévention et la répression des guerres d’extermination contre des groupes et des peuples. Le large corpus normatif, juridique et judiciaire réuni dans ce livre débouche sur ce verdict de justice du génocide des Arméniens, soulignant de plus combien la connaissance des faits avant, pendant et après 1915 a été déterminante dans l’incrimination nouvelle du crime de génocide par Raphael Lemkin et dans l’élaboration de la convention des Nations Unies pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée à Paris, par l’Assemblée générale, le 9 décembre 1948.
Cet ouvrage, Arménie. Un génocide devant la justice, paraît chez un éditeur de référence, Les Belles Lettres, comme le premier Arménie, preuve de l’importance du sujet et même de son caractère crucial. Son contexte de parution n’est pas seulement celui de la 110e commémoration du génocide des Arméniens. Elle intervient alors que la justice pénale internationale subit les attaques les plus graves depuis sa création au lendemain de la Seconde Guerre et de la découverte du deuxième génocide dans l’histoire. Ces attaques proviennent d’Etats de tyrannie comme la Russie et la Chine mais aussi d’États de démocratie dominés par des politiques antidémocratiques, celle du président américain Donald Trump et celle du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu. La défense de ces institutions essentielles à un monde de droit, de connaissance et de justice justifie que nous en exposions l’histoire, lors de conférences internationales ou nationales comme à Sacramento aux Etats-Unis (Université de Californie, novembre 2024), à Erevan en Arménie (Global Forum, décembre 2024), à Paris à La Courneuve (Archives diplomatiques-APHG, avril 2025), à Montpellier à l’Université Paul-Valéry (CRISES-CSI-CESPRA-Institut Maïmonide, juin 2025).
Depuis notre première étude sur le sujet en 1999, co-écrite avec Gilles Pécout, issue d’une communication au colloque de la Sorbonne, « Les exclus en Europe[31] », nous avons poursuivi nos recherches sans discontinuer, les confrontant à l’histoire et à l’historiographie des génocides et des atrocités de masse. Il s’agit d’un engagement de savoir, de haute intensité, que nous n’abandonnerons jamais tant il interroge le monde et sa dimension d’humanité, d’inhumanité[32]. Aucune fatalité n’est concevable dans les mécanismes de destruction physique et métaphysique de groupes humains. La connaissance scientifique est à ce prix, avec son ambition de comprendre à l’impensable, et de défier les tyrannies, hier comme aujourd’hui et comme demain.
[1] Officiellement, depuis le 1er janvier 2023, administrateur de l’État dans les fonctions d’inspecteur général de l’éducation, des sports et de la recherche.
[2] La France face au génocide des Arméniens, du milieu du XIXe siècle à nos jours. Une nation impériale et le devoir d’humanité, Paris, Fayard, 2015.
[3] « “Les lampes de l’épicier Karabet”. L’historien et les mondes disparus » Rapport de synthèse, HDR, « Histoire des engagements démocratiques depuis le XIXe siècle » (garant : Christophe Charle), soutenue à l’Université de Paris 1-Panthéon Sorbonne le 25 juin 2015, 3 vol.
[4] « L’usage des savoirs. L’engagement des savants dans l’affaire Dreyfus, 1894-2006 », sous la direction de Madeleine Rebérioux (†) puis de Dominique Kalifa, soutenue à l’Université de Paris 1-Panthéon Sorbonne le 17 juin 2009, 2 vol., partiellement publiée en 2010 sous le titre : L’affaire Dreyfus. Quand la justice éclaire la République,Toulouse, éditions Privat.
[5] . « Je n’étais pas socialiste. J’étais “libéral” en ce sens que j’étais anticlérical, démocrate, républicain, disons d’un seul mot qui était alors lourd de sens : un “dreyfusard” », in L’Ère des tyrannies [1938], Paris, Gallimard, coll. « Tel », 1990, p. 216. Désormais réédité dans le cadre des « œuvres complètes d’Élie Halévy » (sous la direction de Vincent Duclert et de Marie Scot) : Élie Halévy, L’ère des tyrannies. Etudes sur le socialisme et la guerre [1938], édition critique in extenso, avec introduction, documents et notes par Vincent Duclert, préface de Nicolas Baverez, Paris, Les Belles Lettres, 2016, 768 p.
[6] « Il faut sauver les Arméniens » est le titre que nous avons donné à l’édition des discours de Jean Jaurès en défense des Arméniens massacrés (Paris, Mille et une nuits, 2006, rééd. 2015).
[7] Ibidem.
[8] Arnold J. Toynbee, Les massacres des Arméniens, 1915-1916 [1915], préface de Lord Bryce, Paris, Payot, 1916, rééd. Payot-Rivages, 1987, préface de Claire Mouradian (titre original : Armenian Atrocities. The murder of a nation).
[9] « Les historiens et la destruction des Arméniens », Vingtième siècle. Revue d’histoire, n°81, janvier-mars 2004, p. 137-153.
[10] « L’Empire ottoman et la conduite de la guerre », inStéphane Audoin-Rouzeau et Jean-Jacques Becker (dir.), Encyclopédie de la Grande Guerre 1914-1918, Paris, Bayard, 2004,pp. 519-532. « La paix et la Turquie kémaliste », in ibid.,p. 1033-1046. « La destruction des Arméniens », in ibid.,p. 381-392.
[11] « Atatürk, Mustapha Kemal », « Armenia », et « Armenian Genocide » in Jay Winter and John Merriman (eds.), Europe since 1914. The Age of War and Reconstruction, Charles Scribner’s Sons/Thomson Gale, 2006.
[12] « Quelles évolutions et recompositions récentes en Turquie sur la question du génocide arménien ? Essai de bilan critique et d’histoire immédiate », en collaboration avec l’IFI et le CETOBAC. Nous avions participé à cette conférence. Depuis nous ne sommes plus revenu en Turquie, conscient des risques pour notre sécurité.
[13] D’abord interdite par la justice et empêchée d’être tenue à l’université du Bosphore, la conférence universitaire a été finalement organisée à l’université de Bilgi.
[14] Nous avons présenté un tel bilan historiographique lors de la journée d’étude mentionné du 6 mars 2015 à Istanbul.
[15] Vincent Duclert (éd.), Jean Jaurès, Il faut sauver les Arméniens, Paris, Mille et une nuits, 2006 rééd. 2015), avec une introduction : « Du combat pour les Arméniens à la défense du capitaine Dreyfus : “Une catholicité de la justice” », pp. 57-70.
[16] « Jean Jaurès et la Turquie. La fêlure des massacres arméniens », in Jaurès, du Tarn à l’Internationale, préface de Gilles Candar, Paris, Fondation Jean Jaurès, coll. « Les essais », 2011, pp. 89-113.
[17] Notre premier travail de recherche sur Élie Halévy fut la participation à l’édition de sa correspondance générale, préfacée par François Furet : Elie Halévy, Correspondance 1891-1937, textes réunis et présentés par Henriette Guy-Loë et annotés par Monique Canto-Sperber, Vincent Duclert et Henriette Guy-Loë, préface de François Furet, Paris, Bernard de Fallois, 1996.
[18] Élie Halévy, L’ère des tyrannies. Penser en résistance, préface de Perrine Simon-Nahum, Paris, Les Belles Lettres, coll. « Le goût des idées », 2024.
[19] Rapport de la Mission d’étude en France sur la recherche et l’enseignement des génocides et des crimes de masse, édition par Vincent Duclert, préface de Dominique Schnapper, postface d’Henry Rousso, Paris, CNRS Editions, 2018 ; Penser les génocides. Itinéraires de recherche, édition par Vincent Duclert, Paris, CNRS Editions, 2021.
[20] Sans aucune hésitation, il a, comme le jeune professeur de droit spécialiste du négationnisme (enseignant à l’époque à l’université de Reims) Thomas Hochmann, répondu à notre invitation de rejoindre la Commission de recherche. Leur rôle a été de grande importance dans la réalisation et la conclusion de l’étude sur la France et le génocide des Tutsis au Rwanda.
[21] Commission de recherche sur les archives françaises relatives au Rwanda et au génocide des Tutsi, La France, le Rwanda et le génocide des Tutsi, Rapport au président de la République, sous la présidence de Vincent Duclert (complété par : « Annexe méthodologique » et « Etat des sources », site : vie-publique.fr / Rwanda), Paris, Armand Colin, 2021.
[22] Raymond H. Kévorkian, Parachever un génocide. Mustafa Kemal et l’élimination des rescapés arméniens et grecs (1918-1922), Paris, Odile Jacob, 2023.
[23] Arménie. Un génocide sans fin et le monde qui s’éteint, Paris, Les Belles Lettres, 2023.
[24] Ibidem.
[25] Franz Werfel, Les Quarante jours du Musa Dagh, traduit de l’allemand par Paule Mofer-Bury, Paris, Albin Michel, 1936, rééd. 2015, avec une préface d’Élie Wiesel, « Le crime de l’oubli ».
[26] Jean Jaurès, Les Preuves. Affaire Dreyfus [1898], préface de Jean-Denis Bredin, introduction de Madeleine Rebérioux, notes de Vincent Duclert, Paris, La Découverte, 1998, p. 48.
[27] En réalité, 53 jours de résistance.
[28] Franz Werfel, Les Quarante jours du Musa Dagh, op. cit., p. 917.
[29] Ibid., p. 916.
[30] Vincent Duclert, Thomas Hochmann, Raymond H. Kévorkian, Arménie. Un génocide devant la justice, Paris, Les Belles Lettres, 2025.
[31] Vincent Duclert et Gilles Pécout, « Les intellectuels français face aux massacres d’Arménie », in André Gueslin et Dominique Kalifa (dir.), Les exclus en Europe, Paris, Éditions de l’Atelier, 1999, p. 323-344.
[32] Vincent Duclert, « La déshumanisation, mécanisme central des processus génocidaires et des génocides », « L’inhumanité dans l’humanité », En Jeu. Histoire et mémoires vivantes, 2024, p. 137-150.
Articles récents
Nos partenaires
Le Souvenir Français est la plus ancienne association mémorielle en France (création en 1887). Elle n’a qu’une ambition « servir la nation républicaine » en sauvegardant la mémoire nationale de la France. Afin d’atteindre cet objectif, Le Souvenir Français entretient des liens amicaux avec de nombreuses associations qui œuvrent en totalité ou partiellement afin de faire vivre […]
Voir l'article >Une photo et son histoire
Le monument du Souvenir Français d’Yvetot Monument du Souvenir Français à Yvetot. Situé dans la partie haute du cimetière Saint-Louis à Yvetot, en Normandie, le monument aux morts rend hommage aux soldats des armées de terre et de mer originaires des communes du canton d’Yvetot, tombés pour la Patrie. On peut y lire l’inscription : […]
Voir l'article >Journal du Président Général pour janvier 2026
Retrouvez dans cette rubrique les principales actions et déplacements du Président général du Souvenir Français pour le mois passé. Mercredi 7 janvier 2026 La commémoration du 95ème anniversaire des obsèques du Maréchal Joffre à Louveciennes (Yvelines) n’était pas banal. Présidé par le Préfet du département, cette cérémonie marquait la « victoire » juridique obtenue afin d’accéder à la […]
Voir l'article >