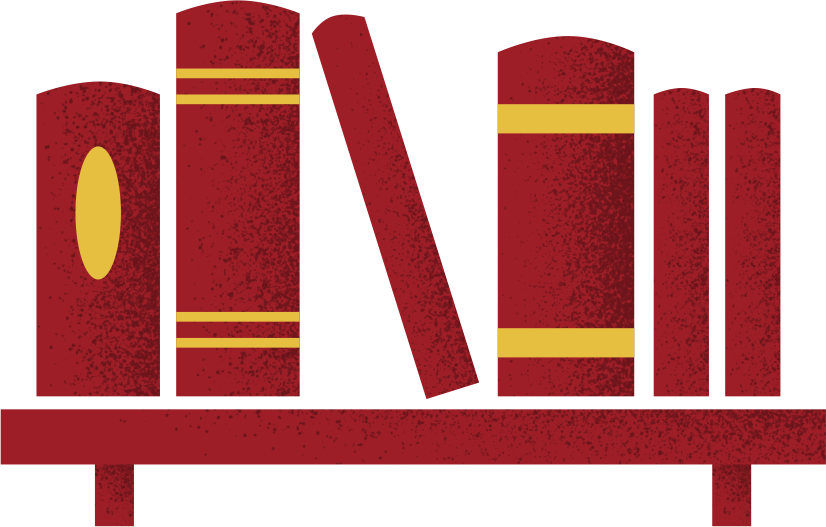Le mémorial de Musa Ler (Arménie)

Le Mémorial de Musa Ler
À proximité d’Erevan se dresse le Mémorial de Musa Ler, élevé en 1947 en hommage à la résistance arménienne du Musa Dagh en 1915.
Le Musa Dagh est un piton rocheux du sud-ouest de la Turquie, situé entre la ville d’Antioche et la côte méditerranéenne, et culminant à plus de 1 350 mètres, qui abritait, sur ses hauteurs, plusieurs villages arméniens.
Au fil de l’année 1915, les ordres de déportation de la population arménienne de l’actuelle Turquie, émis par le gouvernement ottoman, atteignirent en juillet 1915 les six villages arméniens de la région du Musa Dagh. Le 13 juillet 1915, les autorités ottomanes ordonnent aux 5 000 à 6 000 habitants de ces six villages de se préparer à la déportation. Malgré l’approche des forces turques ottomanes convergeant vers la ville, la population de ces six villages refuse la déportation et se retire sur le Musa Dagh, emportant tout avec eux pour leur survie : nourriture, bétail, mais surtout toutes les armes disponibles : 120 fusils modernes, 300 vieux fusils (dont certains à pierre), quelques pistolets, des barils de poudre et des cartouches.
Menés par Movses Der Kalousdian, les réfugiés arméniens vont déjouer les assauts des Turcs pendant cinquante-trois jours, de juillet à septembre 1915.
Le 21 juillet 1915, 200 soldats turcs montent à l’assaut des hauteurs et sont repoussés une première fois : le canon turc est hissé sur les reliefs, mais un combattant arménien abat plusieurs artilleurs. Les Turcs mettent le canon à l’abri et reviennent en force : 3 000 soldats réguliers et 4 000 soldats volontaires face auxquels se dresse une escouade d’Arméniens, qui se font tuer un par un. Les Turcs progressent; un seul et dernier ravin les sépare bientôt des assiégés. C’est pourquoi ils décident de passer la nuit en embuscade avant l’attaque finale au petit matin. Mais durant la nuit, les Arméniens, qui connaissent parfaitement le terrain, descendent vers le campement turc et tirent à bout portant, abattant ainsi plus de 200 soldats ottomans et récupérant une grosse quantité d’armement.
Les Turcs rassemblent alors toute la population musulmane du secteur jusqu’à atteindre le nombre de quelque 15 000 hommes, qui encerclent bientôt toute la montagne, à l’exception du versant tourné vers la mer, réputé impraticable du fait de ses pentes vertigineuses. Acculés, les insurgés dépêchent un messager arménien vers Alep, où réside le consul américain, pour demander du secours. Il franchit les lignes turques, mais il est tué sur le chemin.
Les résistants envoient alors un bon rameur, qui parvient à déjouer la vigilance des Turcs et à gagner la côte. Malheureusement, il ne rencontre aucun navire allié dans les parages. En dernier ressort, les rescapés rédigent en trois exemplaires un appel confié à trois nageurs prêts à braver les vagues pour approcher tout bâtiment allié. Le message indique : « Au nom de Dieu et de la fraternité humaine, nous implorons tout Anglais, Américain, Français, Italien ou Russe, qu’il soit amiral, capitaine, ou telle autre autorité. Nous, la population de six villages arméniens, environ 5 000 âmes, nous avons fui devant la torture barbare des Turcs, mais surtout devant l’outrage de l’honneur de nos femmes. Nous vous implorons au nom du Christ ! Nous vous en prions, transportez-nous à Chypre ou dans quelque autre terre libre. Notre peuple n’est pas paresseux ; nous gagnerons notre pain, si on nous donne du travail. Si c’est trop vous demander, transportez au moins nos femmes, nos vieillards et nos enfants. Nous vous en prions, n’attendez pas qu’il soit trop tard ».
Le 5 septembre 1915, au 46ème jour de résistance, tandis que les munitions se font rares et qu’il ne reste plus que quelques jours de nourriture, les réfugiés aperçoivent un navire au loin. Ils agitent alors le drapeau à croix rouge, auquel le bateau répond par un signal. C’est le Guichen, un bâtiment français, qui a décide d’approcher de la côte, très découpée. Les nageurs arméniens se jettent à l’eau, bravent les flots et transmettent le message. D’autres navires français rejoignent le Guichen et bombardent les Turcs qui se retirent des pentes du Musa Dagh. Le 11 septembre, des radeaux sont mis à l’eau par les équipages français pour rejoindre la grève, car s’approcher du littoral était trop dangereux pour les navires. Trois heures vont être nécessaire pour amener les embarcations au contact des survivants, tant la mer est forte. Il faut manœuvrer prudemment jusqu’à la nuit pour embarquer tous les rescapés. Les femmes, les enfants et les vieillards sont embarqués en priorité. Il ne reste plus que les combattants toujours embusqués au sommet du Musa Dagh. Dès le lendemain matin, après avoir regroupé et brûlé toutes leurs affaires, ces derniers dévalent la pente et rejoignent les navires.

Un navire de guerre français embarque des réfugiés arméniens du Musa Dagh en septembre 1915.
Le 10 septembre 1915, Albert Defrance, ministre de France au Caire, avait envoyé au ministre des Affaires étrangères, Théophile Delcassé, la dépêche suivante : « À Djebel Moussa, dans le Sud, ainsi que dans le golfe d’Alexandrette et près d’Antioche, 6 000 Arméniens se sont révoltés pour éviter d’être massacrés. Ils demandent à nos bâtiments de guerre de leur donner des armes pour se défendre et d’amener en lieu sûr leurs femmes et leurs enfants ».
La décision avait en réalité déjà été prise par les officiers français. Sans réponse du ministère de la Marine, le vice-amiral Louis Dartige du Fournet, commandant la 3ème escadre de la Méditerranée, et son homologue le contre-amiral Gabriel Darrieus avaient en effet décidé d’évacuer les Arméniens du Musa Dagh, une semaine avant l’exécution de l’opération, temps nécessaire à la mise au point des détails. Dès le 14 septembre, 4 092 rescapés pourront être débarqués à Port-Saïd, en Égypte.
À partir de 1918, lorsque le Sandjak d’Alexandrette passe sous contrôle français, la population des six villages arméniens retourne chez elle. En 1932, un monument est érigé au sommet de la montagne pour commémorer l’événement.

Vestiges du 1er monument érigé en haut du Musa Dagh dans l’actuelle Turquie.
Mais le 29 juin 1939, à la suite d’un accord entre la France et la Turquie, la province est cédée à la Turquie et le monument détruit.
Les résistants survivants du Musa Dagh ont émigré en Arménie Orientale et ont fondé à proximité d’Erevan le village de Musaler, où, en 1947, un mémorial dédié à cette résistance historique a été inauguré.
Surplombant une longue rampe d’escaliers, le mémorial, de 18m de haut, est construit en pierre de tuf rouge, et prend la forme d’un aigle, semblable à celui figurant sur les armoiries du pays. À l’intérieur, son musée est conçu comme un bateau, célébrant ainsi la marine française menée par le vice-amiral Louis Dartige du Fournet.
À proximité, une fontaine à laquelle est apposée une stèle gravée des noms des vingt-six marins français ayant participé à l’opération de sauvetage a été inaugurée en 2018.
Articles récents
Nos partenaires
Le Souvenir Français est la plus ancienne association mémorielle en France (création en 1887). Elle n’a qu’une ambition « servir la nation républicaine » en sauvegardant la mémoire nationale de la France. Afin d’atteindre cet objectif, Le Souvenir Français entretient des liens amicaux avec de nombreuses associations qui œuvrent en totalité ou partiellement afin de faire vivre […]
Voir l'article >Une photo et son histoire
Le monument du Souvenir Français d’Yvetot Monument du Souvenir Français à Yvetot. Situé dans la partie haute du cimetière Saint-Louis à Yvetot, en Normandie, le monument aux morts rend hommage aux soldats des armées de terre et de mer originaires des communes du canton d’Yvetot, tombés pour la Patrie. On peut y lire l’inscription : […]
Voir l'article >Journal du Président Général pour janvier 2026
Retrouvez dans cette rubrique les principales actions et déplacements du Président général du Souvenir Français pour le mois passé. Mercredi 7 janvier 2026 La commémoration du 95ème anniversaire des obsèques du Maréchal Joffre à Louveciennes (Yvelines) n’était pas banal. Présidé par le Préfet du département, cette cérémonie marquait la « victoire » juridique obtenue afin d’accéder à la […]
Voir l'article >