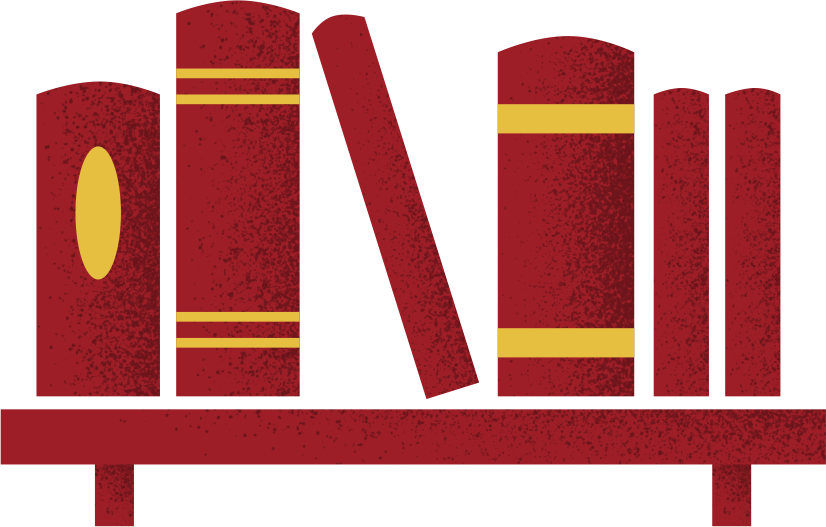LA CREATION 11 NOVEMBRE : UN ENJEU MÉMORIEL COMPLEXE (1918 – 1922)

Rémi Dalisson, professeur des Universités à Rouen a publié treize ouvrages. Elève de Maurice Agulhon et d’Alain Corbin, il travaille sur les sociabilités, les politiques symboliques et les commémorations aux XIXe-XXe siècles. Depuis sa thèse soutenue en Sorbonne et consacrée aux fêtes en Seine-et-Marne pendant ces deux siècles, il a publié de nombreux ouvrages sur le sujet notamment pendant la période vichyste (Les fêtes du Maréchal, 2008, prix F. Millepierres de l’Académie) et sur les mémoires de la Grande Guerre (Histoire du 11 novembre, de la mémoire de la Grande Guerre en 2013) comme de celles de 1870 (Les guerres et la mémoire, 2013). Par ce biais, il travaille aussi sur les rapports entre histoire et mémoire, y compris celles des conflits contemporains (Guerre d’Algérie, l’impossible commémoration, 2018) et des mythes politiques. Il étudie aussi la laïcité et la République à travers les biographies de Paul Bert (2015) et Hippolyte Carnot (2011) et travaille sur les régimes politiques français comme la Seconde République et le Second Empire. Il a en outre participé à une dizaine d’ouvrages collectifs et à plus de soixante colloques et conférences ; il forme les futurs enseignants en les préparant aux concours, donne des cours aux étudiants des IEP et dirige ou participe à de nombreuses thèses.
La Grande Guerre est un traumatisme qui fait près de vingt millions de victimes au total, et pour la France 1,4 million de morts, quatre millions de blessés psychiques comme physiques et un demi-million de veuves, sans même parler des orphelins. Dès lors, comment honorer cette mémoire terrible, même couronnée par la victoire ? Une commémoration semble s’imposer dans un pays féru de fêtes nationales[1] où la Troisième République estime qu’« un peuple libre a besoin de fêtes publiques […] (où) se retrempent la foi dans la patrie et l’amour de la liberté[2] » pendant que Léon Gambetta estime, après 1870, que « les souvenirs fortifient les âmes, forment les caractères […] Une grande nation doit honorer ses morts[3] ». Or il n’en est rien, bien au contraire, et le consensus de l’Union Sacrée vole vite en éclat. Pendant quatre ans le pays, hanté par la mort de masse, hésite en effet sur le sens à donner à une telle célébration et sur la manière d’en faire une catharsis civique, avant d’arriver laborieusement au consensus de la loi du 24 octobre 1922 fondant la fête nationale du 11 novembre.
Les origines du 11 novembre : commémorer pendant la Grande Guerre
Pourtant tout semble commencer sous les meilleurs auspices et, avant même la fin de la guerre, les projets se multiplient pour honorer et commémorer les « Morts pour la France ». Ainsi le 20 novembre 1916, François Simon, Président de la section locale du Souvenir Français, prononce un discours au cimetière de l’Est à Rennes : « Pourquoi la France n’ouvrirait-elle pas les portes du Panthéon à l’un de nos combattants ignorés, mort bravement pour la patrie ? [4]». De son côté, l’écrivain Jean Ajalbert, dont le fils est mort en novembre 1914, lance l’année suivante une grande enquête Comment glorifier les morts pour la Patrie ? Puis, alors que la fin des combats approche, le 12 juillet 1918, un député d’Eure-et-Loir propose d’élever un tombeau à un soldat anonyme tombé pour la patrie, idée reprise par le président de la Société française de Berne qui propose même le transfert de sa glorieuse dépouille au Panthéon. Et à l’Assemblée, un consensus semble émerger pour célébrer au Panthéon un Soldat inconnu, « fils de toutes les mères qui n’ont pas retrouvé leur fils[5] » selon le Général Weygand.
Il est vrai que l’Etat crée rapidement un matériel commémoratif destiné à être utilisé lors d’une grande célébration de la victoire française et/ou de l’armistice. Il fonde ainsi la « Croix de guerre » (8 avril 1915) puis le « Diplôme aux morts pour la Patrie » (27 avril 1916). Mieux encore, alors que les combats battent leur plein et que le nombre des victimes croît inexorablement, la République organise la « fête anniversaire de la victoire de la Marne » qui devient dès 1915 une fête prémonitoire d’une victoire qui ne fait aucun doute dans l’esprit du public comme du gouvernement. On y retrouve une grande partie du rituel de l’anniversaire de l’armistice comme les gerbes aux monuments aux morts provisoires à Barcy ou Chambry en Seine-et-Marne, la Marseillaise, la minute de silence non encore codifiée, la présence des écoles, les médailles et la litanie des morts au combat. Et sur le terrain, de nombreuses communes, comme Notre-Dame-du-Port en 1916, Clermont-Ferrand en 1915 ou Dijon en 1916 et 1917, organisent des cérémonies patriotiques locales avec cortèges, dépôts de gerbes et messes chaque Toussaint pour honorer leurs enfants morts pour la patrie.
Cependant, tout s’accélère avec la fin du conflit et la prise de conscience traumatique de la réalité de la mort de masse. Mais paradoxalement, à l’inverse des débuts de la guerre, le consensus commémoratif peine à émerger.
Deux visions pour une même commémoration
Pourtant, à peine les combats achevés, le président du Conseil Georges Clemenceau s’exclame devant le Sénat à qui il annonce l’armistice : « J’ai dit que c’était l’œuvre de nos grands morts qui nous ont fait cette admirable journée. Grâces leur soient rendues : […] il faudra qu’un jour de commémoration soit institué en leur honneur dans la République française[6] ». Dans une France éprise de commémorations, réaliser une cérémonie patriotique semble aller de soi. Or, malgré l’Union Sacrée et la solidarité des temps de guerre, il n’en est rien. Deux camps vont s’affronter pendant quatre longues années, de 1918 à 1922, sur le sens à donner à une telle célébration, à tel point qu’une seconde fête nationale est créée dans l’intervalle, la fête de Jeanne d’Arc dite « fête du patriotisme » en 1920.
Le premier camp est celui de l’Etat qui, bien qu’il soit conscient des souffrances endurées, préfère célébrer de manière classique la victoire politique de la République et de ses valeurs. Pour ces hommes politiques, avant même d’honorer les morts que l’on ne peut évidemment oublier, la future commémoration doit montrer avec faste que la guerre fut la Revanche tant espérée, le retour triomphal de l’Alsace Moselle et la victoire du droit. Son modèle est le gigantesque (deux millions de spectateurs accourus à Paris) et fastueux 14 juillet 1919 dit « de la victoire » où, malgré le défilé des gueules cassées en tête de cortège, c’est bien la victoire militaire et politique du régime qui compte comme le résume la statue du coq vainqueur placée au-dessus des canons allemands[7].
Dans une telle célébration, fière et joyeuse, les morts et anciens combattants ne sont pas le thème principal qui reste celui de l’exaltation la République qui a survécu à la guerre. Pour l’Etat, la future fête sera donc classique avec ses parades, discours et toasts politiques, ses musiques, fanfares et hommages républicains triomphalistes. Comme un 14 juillet, elle sera une démonstration de la force de la République qui triomphe de la mort et de la guerre grâce aux conquêtes de 1789 que les discours officiels rappelleront avec emphase.
Tel n’est pas l’avis des anciens combattants, survivants de l’enfer et rescapés des huit millions de mobilisés, soit près de la moitié de la population active et de l’essentiel des jeunes adultes du pays. Nombreux sont ceux qui reviennent blessés et tous sont psychologiquement traumatisés, ce que la société ne reconnaît alors pas[8]. Nostalgiques de la fraternité des tranchées et désireux de se faire entendre, presque la moitié des mobilisés, soit plus de trois millions d’hommes, adhèrent aux porteurs de mémoire que sont les associations d’anciens combattants. Très variées, de gauche comme l’ARAC, de droite comme l’UNC[9] voire d’extrême-droite comme les Croix de feu avec son demi-million de membres, elles forment un gigantesque groupe de pression qui n’entend pas se faire voler la commémoration de son sacrifice. Pour ces hommes, plus que la République, une cérémonie commémorant la guerre doit avant tout honorerles victimes, ces « copains » comme on disait alors, les mutilés (un demi million dont 15 000 touchés au visage, les fameuses « gueules cassées ») et surtout les morts, c’est-à-dire tous les combattants qui ont souffert.
Célébrer la victoire militaire avec la gloriole et les flonflons usuels ne les intéresse pas et leur semble une récupération honteuse devant les souffrances d’une victoire si chère payée. Ce sont le seul recueillement et le silence devant la douleur des survivants et des familles qui doivent régner car cette guerre doit être « la Der des Ders » tant évoquée dans les tranchées. La célébration ne doit donc comporter aucun faste, aucune fanfare, aucun défilé, revue ou arme rutilante et surtout aucun discours, surtout pas de politiques prompts à instrumentaliser la victoire.
Les seules paroles tolérées par ces anciens sont celles des survivants pour faire la pédagogie de la paix, notamment à destination des enfants, futurs citoyens et soldats. La commémoration prend ici son sens doloriste mais aussi civique au sens de pacifiste. Comme dit le Journal des mutilés : « Supprimons tout ce qui peut éveiller le militarisme. […] Plus de cérémonies guerrières […] qui excitent l’imagination[10] ». Le Serment de Verdun de novembre 1936 l’illustre parfaitement : ce jour-là 20.000 combattants européens prêtent serment contre la guerre devant l’ossuaire de Douaumont où sont rassemblés 130 000 ossements et restes de soldats inconnus de tous pays.
La longue marche vers le 11 novembre (1918-1922)
De l’automne 1918 à celui de 1922, la République hésite donc sur le sens à donner à la commémoration de la Grande Guerre, chose d’autant plus paradoxale qu’elle se penche immédiatement sur sa mémoire d’un point de vue financier, social et culturel[11].
Si l’année 1919 est dédiée, on l’a vu, à la célébration triomphale de la victoire le 14 juillet, et à des commémorations locales et discrètes des « tombés pour la France », c’est l’année suivante que les tensions commémoratives se nouent.
L’année 1920 voit ainsi s’effectuer un étrange jumelage entre deux célébrations patriotiques le même jour, le 11 novembre. La première résulte de la loi du 8 novembre 1920, votée à l’unanimité, autour du Soldat inconnu qui doit être inhumé sous l’Arc de triomphe le jour anniversaire de l’Armistice. C’est l’origine du culte du Soldat inconnu autour de la flamme de l’Arc de triomphe allumée en 1923 par l’ancien combattant devenu ministre André Maginot[12]. Un mois avant, une autre loi[13] avait déjà instauré le recensement systématique des morts pour la France dans des « livres d’or » communaux. Mais ce 11 novembre est aussi le jour de la célébration du cinquantième anniversaire de la Troisième République symbolisée par la translation du cœur de Gambetta au Panthéon, cérémonie qui minore le souvenir de la Grande Guerre et éclipse la vision ancien combattante de l’anniversaire de l’armistice.
En 1921, les querelles reprennent car l’anniversaire de l’armistice n’est toujours pas férié et doit être célébré tous les ans le dimanche[14] le plus proche du 11 novembre pour ne pas gêner la reconstruction économique, ce qui en réduit la portée et surévalue le religieux d’autant que la fête Jeanne d’Arc semble préempter le patriotisme. Furieux, les anciens combattants boycottent alors la cérémonie et leurs associations protestent officiellement. Sur le terrain, au grand dam des laïques, les commémorations de la Grande Guerre et de ses morts se replient sur les très religieux 1er-2 novembre.
L’année suivante, la tension est donc à son maximum et le gouvernement est tétanisé devant les protestations des anciens combattants, d’autant que la « communauté du deuil », soit les familles et proches des morts représentent près de la moitié de la population[15].
Il cède donc aux demandes pressantes des anciens Poilus et adopte la loi d’octobre 1922 décrétant le 11 novembre férié et chômé, « fête anniversaire de l’armistice et de la paix » centré sur le recueillement, le silence et l’absence d’armes. Soulagée, l’Union française des mutilés s’exclame le 22 octobre 1922 : « enfin nous avons notre fête nationale […] les Anciens combattants devaient avoir leur journée de recueillement et de souvenir ». Le 11 novembre devient la célébration d’une mémoire souffrante et une pédagogie civique pour la paix plus que pour des valeurs républicaines.
Le 11 novembre au village : un rituel cathartique spécifique
La scénographie du 11 novembre est à la fois classique et originale avec ses messes, défilés d’associations, minutes de silence pour reformer l’unité de la nation, gerbes de fleurs, drapeaux, appel aux morts par des pupilles de la nation ou d’anciens poilus, sonneries, remises de médailles ou diplômes et Marseillaise. Elle met en avant la mémoire souffrante et compassionnelle autour des monuments aux morts qui couvrent la France en cinq ans. Certaines villes en ont même deux comme Rouen, le premier au cimetière de Saint-Sever, le second dit « de la victoire » édifié en 1925 par Réal del Sarte. On en trouve partout jusque dans le métro parisien (à Richelieu-Drouot à Paris), les établissements scolaires, les gares ou préfectures. Il s’agit, comme le souhaitent les anciens Poilus, de se souvenir pour détester la guerre, de vanter la paix et accessoirement rappeler que l’Alsace-Lorraine est bien revenue à la France. Selon les divers monuments, le Poilu magnifié par le 11 novembre devient un héros souffrant qui défend la France et meurt pour elle autant que pour la paix en laissant un pays dépeuplé et traumatisé comme le montre le monument de Paul Dardé à Lodève.
Mais tout le monde ne donne pas le même sens à cette tragédie. Pendant tout l’entre-deux-guerres, trois groupes interprètent en effet le 11 novembre à travers des associations et pratiques différentes. Ils s’y affrontent tous les ans, et parfois violemment au mépris du message pacifiste des anciens combattants car, dès 1923 la politique reprend le dessus au mépris de la mémoire souffrante. Il s’agit d’abord de la gauche, surtout du jeune PCF fondé en 1920 pour qui la guerre est née du capitalisme. Il faut donc le renverser pour éviter un nouveau conflit et bâtir un nouveau monde socialiste. Puis vient l’extrême-droite des Ligues qui estime que la guerre est due à la République et à la démocratie. Il faut donc les remplacer pour bâtir une France nouvelle, prérévolutionnaire et soudée derrière un chef autoritaire gouvernant les seuls « vrais Français ». Et l’on trouve dans ces deux camps les pacifistes qui veulent simplement qu’il n’y ait plus jamais de guerre. Chacun de ces groupes manifeste alors le jour du 11 novembre et provoque des incidents[16] avec des défilés officieux, de la violence (les Camelots du Roi), des cris, des chants subversifs (l’Internationale) et des altérations des monuments aux morts qui font de cette fête, à l’origine dédiée au recueillement silencieux, le réceptacle des passions françaises.
La création de la fête nationale du 11 novembre fut donc longue et, malgré le poids des souffrances, jamais consensuelle. Mais son rituel particulier s’est vite enraciné et n’a jamais disparu, y compris pendant l’épisode vichyste où il est adapté par Pétain et revendiqué comme symbole de la République par les Résistants[17]. Sa commémoration résiste à toutes les crises (mai 1968 ou le Covid en 2019-20) et malgré la loi de 2012 qui le modifie[18] et une réelle désaffection du public, il reste de nos jours le symbole de la Grande Guerre. Il est toujours un moment de recueillement autour de ce conflit, mais aussi un temps de réflexion sur la notion de sacrifice pour une cause, une pédagogie civique comme le voulaient les Poilus, à présent dans le cadre européen.
Rémi Dalisson, professeur des Universités, Université-Inspe de Rouen
[1] . Voir Rémi Dalison, Célébrer la nation. Les fêtes nationales en France de 1789 à nos jours, Paris, Nouveau Monde, 2009.
[2]. Paul Bert, De l’éducation civique, Conférence du Trocadéro, 6 août 1882, p. 24.
[3] . Léon Gambetta, dans Joseph Reinach, Discours et plaidoyers de M. Gambetta, Paris, 1883, p. 311-312.
[4] . https://le-souvenir-francais.fr/wp-content/uploads/2019/09/Octobre2016.htm/ 21/09/2021.
[5] Général Weygand, Le 11 novembre, Flammarion, Paris, 1932, pp. 131-132.
[6] . https://www.senat.fr/evenement/archives/clemenceau/discours2.html/ (21/09/2021).
[7] . Voir Victor Demiaux, « 14 juillet 1919, que la fête commence ! », L’Histoire, n°449, été 2018, pp. 43-50.
[8] . Louis Crocq, Les blessés psychiques de la Grande Guerre. Paris, O. Jacob, 2014.
[9] . ARCAC : Associations républicaine des Anciens combattants fondée par Barbusse, UNC : Union nationale des Combattants fondée par le père Brottier. Voir Antoine Prost, Les anciens combattants et la société française, 1914-1939, Paris, Gallimard, 1977.
[10] . Journal des Mutilés, 13 juillet 1919, cité par Antoine Prost, voire note précédente.
[11] . Voir Rémi Dalisson, Histoire de la mémoire de la Grande Guerre, Paris, Sotéca, 2013.
[12] . Sur le soldat inconnu voir Jean-Yves Le Naour, Le soldat inconnu, la guerre, la mort la mémoire, Paris, Gallimard, 2008.
[13] . Loi n°15135 du 25 octobre 1919 intitulée « Loi relative à la commémoration et à la glorification des morts pour la France au cours de la grande guerre
[14] . Loi n° 0305 du 10 novembre 1921, art 2 : « La fête sera célébrée le 11 novembre si c’est un dimanche ou dans le cas contraire le dimanche suivant ».
[15] . Voir Stéphane Audoin-Rouzeau, « Qu’est-ce qu’un deuil de guerre ? », Revue historique des armées, 259 | 2010, 3-12.
[16] . Voir Rémi Dalisson, Le 11 novembre, du souvenir à la mémoire, Paris, A. Colin, 2013.
[17] . Voir Rémi Dalisson, Les fêtes du Maréchal, Paris, CNRS, 2015.
[18] . Depuis la loi du 28 février 2012, il est la commémoration de tous les Français morts pour la France au-delà du seul 11 novembre.
Articles récents
Agenda du mois
L’initiative phare du mois d’avril 2024 Vernissage de l’exposition « Les Tirailleurs dits « sénégalais » avant, pendant et après la Première Guerre mondiale », le 4 avril 2024. Le Souvenir Français est heureux d’accueillir cette exposition conçue et réalisée par l’association Solidarité Internationale, le Musée des Troupes de Marine (Fréjus), et le Partenariat Eurafricain. A partir de […]
Voir l'article >Billet d’humeur du Président Général
Au sujet de la création d’une « commission mixte franco-camerounaise pluridisciplinaire portant sur le rôle et l’engagement de la France dans la lutte contre les mouvements indépendantistes et d’opposition au Cameroun de 1945 à 1971. » Cette commission dont la création a été décidée par le président de la République française présente un risque. Alors […]
Voir l'article >Bilan des activités du Président général
En mars 2024 Mercredi 13 mars Le Souvenir Français reçoit le portrait du Général Fournier, premier président du Souvenir Français (1887-1889). Ce portrait est offert par le descendant du Général et présenté par le président du comité du Souvenir Français de Chatenay-Malabry (92). Arrivée du portrait du Général Fournier au siège du Souvenir Français. Pour découvrir […]
Voir l'article >