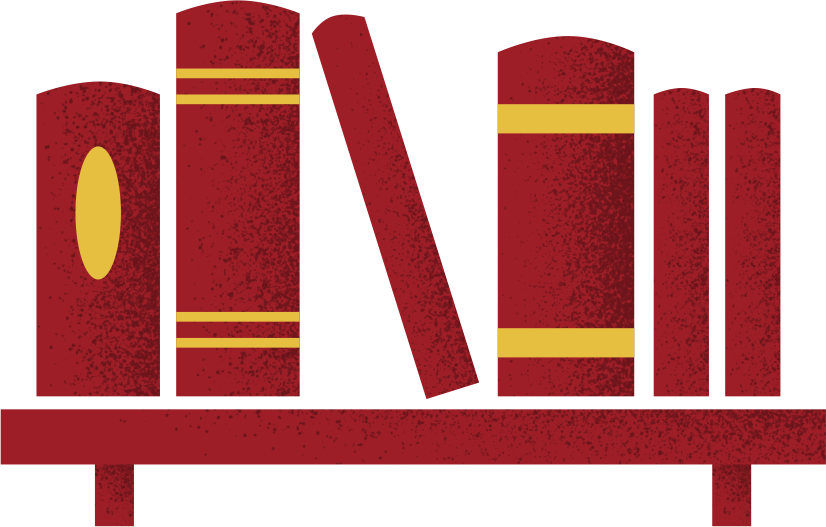Jean-François Chanet est agrégé d’histoire et spécialiste de la France du XIXe siècle. Il est recteur de l’académie de Besançon et président comité scientifique du 150ème anniversaire de 1870.
La guerre de 1870-1871 et l’équilibre européen
La portée de la guerre de 1870-1871 dans l’ordre international et ses effets sur l’équilibre européen[1] peuvent s’évaluer diversement selon l’étendue de la période dans laquelle on les apprécie. On peut situer ce conflit dans trois cercles chronologiques concentriques. Le plus restreint est délimité par la réalisation de l’unité allemande sous la conduite d’Otto von Bismarck, de 1862 à 1871. Un deuxième cercle englobe les crises entre la France et l’Allemagne – en tant qu’espace morcelé où se développe avant 1870 un sentiment national, puis Etat unifié sous la forme du Reich wilhelminien-, de la « question du Rhin » en 1840 aux poussées de fièvre durant l’entre-deux-guerres de 1871 à 1914. Le cercle le plus étendu réunit les deux grands règlements internationaux adoptés au sortir, le premier, des guerres napoléoniennes – l’Acte final du congrès de Vienne (1815)-, le seconde, de la Grande Guerre-les traités de 191961920. On peut même pousser jusqu’à la Seconde Guerre- les traités de 1919-1920. On peut même pousser jusqu’à la Seconde Guerre mondiale si l’on prend en compte l’idée de la « guerre de trente ans » exprimée par le général de Gaulle dans son discours à l’Albert Hall de Londres le 15 novembre 1941, ou la comparaison des « trois épreuves » de 1814, 1871 et 1940 proposée au même moment par Daniel Halévy[2].
Cela ne signifie pas qu’on suppose, entre ces épreuves successives pour la France, une relation téléologique. Il ne s’agit point de prétendre que l’affrontement franco-allemand avait un caractère de fatalité depuis que Napoléon avait précipité la ruine du vieil Empire germanique, ni que le traité de Francfort portait en lui la guerre de 1914, ni que celui de Versailles, trop dur pour l’Allemagne, aurait à son tour rendu inévitable un nouvel affrontement. A la condition de prendre cette précaution de méthode élémentaire, le cadrage le plus large a pour premier avantage de faire ressortir que ce qui est en jeu, dans la guerre de 1870, dépasse en importance les seules relations franco-allemandes, auxquelles, assurément, elle donne pour longtemps un caractère conflictuel. Guerre limitée, c’est entendu, dans l’espace et le temps mais pour un objectif, l’unité allemande, dont la réalisation ne l’était pas. Sa portée est d’emblée européenne donc, eu égard à ce que pesait l’Europe dans les relations internationale et la vie économique d’alors, mondiale.
L’équilibre dont Metternich avait été l’ordonnateur à Vienne en 1814-1815 avait lui-même subi depuis lors plusieurs épreuves, mais aucune plus profonde et plus lourde de conséquences. Tel était l’avis du leader du parti conservateur à la chambre des communes britannique, Benjamin Disraeli. Il l’a donné dans un discours fameux, le 9 février 1871, au lendemain des élections à l’Assemblée nationale française, donc avant même que la guerre ait trouvé son issue. Soucieux de rendre sensible à la Chambre le « caractère de cette guerre », il ne recule pas devant les formules extrêmes : selon lui, elle « représente la Révolution allemande, un événement politique plus grand que la Révolution française du siècle dernier. […] Il n’est pas une tradition diplomatique qui n’ai été balayée. […] L’équilibre des puissances a été entièrement détruit, et le pays qui en souffre le plus, et ressent le plus les effets de ce grand changement, c’est l’Angleterre[3]. » Nous proposons de revenir, dans les lignes qui suivent, sur trois points auxquels ce discours donne un relief particulier : le caractère « révolutionnaire » de ce qui se produit en 1870-1871 ; l’isolement de la France, qui en est à la fois la condition et la conséquence ; enfin, l’intensification prévisible de la compétition entre puissances européennes dans un espace planétaire, au détriment, pensait Disraeli, de l’Empire britannique.
Une révolution
L’équilibre des puissances établi en 1815 avait pour fondements le droit que s’attribuaient les princes victorieux de redécouper les frontières et de redistribuer les territoires, ainsi que le principe de légitimité justifiant la restaurant des souverains que l’empereur déchu avait remplacés. Fruit de la Contre-Révolution, il ne tarda guère à se voir opposer le droit des peuples qui ne trouvaient pas leur compte à ces restaurations, particulièrement dans les péninsules du sud de l’Europe. Dès lors, toute contestation de ce nouvel ordre international, des règles auxquelles il obéissait et des méthodes employées pour le défendre devait être perçue comme un retour de flamme révolutionnaire, à éteindre sitôt déclaré. La Révolution française était la véritable responsable du désordre auquel il avait fallu mettre fin, plus encore que Napoléon, continuateur de ses méfaits.
Le mot de « révolution » en est ainsi venu à designer le lien désormais essentiel entre l’aboutissement d’une aspiration nationalitaire, autrement dit la formation d’un nouvel Etat national, et la remise en cause que celle-ci supposait de l’ordre international établi en 1815, indépendamment même du rôle qu’y jouait la France. Exemplaire est à cet égard le cas de l’Italie, tel que l’a illustré une précédente exposition du musée de l’Armée[4]. La réalisation de l’unité italienne s’est distinguée par une double équivoque : d’une part, « la rencontre du nationalisme des élites modérées avec le nationalisme révolutionnaire mazzinien et garibaldien autour des mêmes thèmes du libéralisme et du progrès humaniste » et « l’instrumentalisation du mouvement populaire par la révolution d’en haut[5] », celle de Cavour et du roi Victor-Emmanuel ; d’autre part, l’appui intéressé de la France, pourtant protectrice des droits et intérêts du pape, principal obstacle à l’achèvement de l’unité. Disraeli n’oubliait pas de rappeler que l’un des traités violés du fait de la guerre de 1870 était la convention du 15 septembre 1864, dont l’article 1er stipulait que l’Italie s’engageait à « ne pas attaquer le territoire actuel du Saint-Père » ; de fait, la prise de Rome, le 20 septembre 1870, avait suivi de peu la défaite de Sedan.
Par rapport à cette double caractéristique, l’unification allemande se distingue moins qu’il n’y paraît d’abord. La Prusse réalise l’unité politique allemande en battant la France, ce qui permet de proclamer le nouvel Empire à Versailles ; mais, allié du Piémont en 1859, Napoléon III était vite devenu un frein pour l’Italie. Et si Bismarck obtient que, contrairement à ce qui s’était passé pour Frédéric-Guillaume IV en 1849, la couronne impériale soit offerte à Guillaume 1er par le roi de Bavière au nom de tous les princes allemands, il n’en a pas moins recherché et obtenu le soutien des nationaux-libéraux, auquel il concède, dans la Constitution du 16 avril 1871 comme dans celle du 17 avril 1967 pour la Confédération de l’Allemagne du Nord, l’élection du Reichstag au suffrage universel. Il y a donc bien en Allemagne aussi une forme d’instrumentalisation des aspirations nationales libérales.
Comparant la « Révolution allemande » et la Révolution française de 1789, Disraeli prend soin de distinguer la portée politique de l’événement de ses « conséquences sociales », encore imprévisibles selon lui. Preuve, s’il en était besoin, qu’il était d’usage, au moins depuis 1830, de dissocier révolution politique et révolution sociale, et d’associer plutôt à la première la dimension internationale, diplomatique[6]. Si son double caractère de bouleversement imprévu et d’avènement national justifie de la qualifier de révolution, le fait que la guerre soit, en 1870 contre la France comme en 1866 contre l’Autriche, le moyen d’atteindre le but politique, dans sa conformité même aux vues de Clausewitz, redouble en quelque sorte le dessaisissement des masses de la décision sur leurs destinées. Jean Jaurès le relève lorsqu’il écrit, à propos des Hohenzollern, dans L’Armée nouvelle : « Ils n’ont pu d’ailleurs réaliser la grande unité allemande et prendre la couronne d’Empire qu’en flattant et captant à leur profit la force révolutionnaire de la démocratie. Mais, pour eux comme pour Napoléon, elle n’est pas une idée ; elle est un fait qu’on utilise, qu’on exploite et qu’on limite[7]. » Que cette victoire ait été non seulement remportée aux dépens de la France mais encore suivie, en France, d’une tentative de révolution sociale écrasée par le gouvernement issu du suffrage universel pour négocier la paix, cela parachevait la démonstration. De ce constat, qu’ils ne partageaient d’ailleurs pas tout à fait, à cause de la place que gardait le nationalisme dans leurs combats, les socialistes français et les sociaux-démocrates allemands ne devaient pas tirer les mêmes enseignements, comme l’attestent tour à tour la réception de L’Armée nouvelle en Allemagne, la polémique de 1912-1913 entre Jaurès et Andler et les débats au sein de l’Internationale[8].
L’isolement de la France
Les premiers signes d’une possible captation nationaliste du mouvement libéral étaient déjà perceptibles en 1840, lors de la « crise du Rhin », qui avait permis au poème Rheinlied de Nikolaus Becker de connaître un succès retentissant – et de susciter la raillerie d’Heinrich Heine[9]. Car le danger que représentait la France- et à nouveau, bien sûr, en 1848 – était précisément celui de l’incendie révolutionnaire étendu jusqu’à la question sociale. La menace de la contagion justifiait d’autant plus la résistance victorieuse des élites traditionnelles, face aux aspirations de la bourgeoisie libérale, dans les pays allemands comme ailleurs, que le « manifeste aux puissances » de Lamartine pouvait faire espérer que la France s’abstiendrait de renouveler 1792 et de déclencher, pour trouver une issue à sa crise politique interne, une guerre européenne. L’évolution ultérieure fait paraître bien illusoire l’assurance que Lamartine tirait de l’effet supposé de sa circulaire : « La France est plus relevée que par vingt campagnes de l’abaissement et de l’impuissance extérieure où elle était[10]. »
Certes, il faut ici faire entrer en ligne de compte la politique étrangère de Louis-Napoléon Bonaparte. Il faut aussi garder à l’esprit que, quelles qu’aient été ses variations entre 1849 et 1870, elle n’explique pas à elle seule le déclenchement de la guerre de 1870. La politique intérieure, les considérations dynastiques, la pression de l’impératrice ont pesé lourd dans la décision de déclarer la guerre à la Prusse, alors que Napoléon III lui-même soutenait un mois auparavant, au témoignage de Prévost-Paradol, qu’il ne pouvait « affronter la guerre que les mains pleines d’alliances[11] ». Or, le 18 juillet, il l’a déclarée les mains vides, et dans un état d’impréparation militaire qui, pour refléter ses hésitations, n’en contrastait pas moins cruellement avec celui de l’adversaire.
La suite ne pouvait que surprendre par son ampleur et sa rapidité, tant restait vive en Europe la crainte de la puissance militaire française. En quelques semaines, le pays envahi, sa capitale assiégée non plus, comme en 1814, par une coalition européenne mais par la seule armée prussienne et ses alliés allemands, c’était un événement inédit. Un bon témoin de la stupeur et de l’inquiétude causées par cette série de désastres est Mgr Gaume, un proche de Louis Veuillot. Dans son « étude sur les événements actuels », il exprime de façon bien significative à la fois l’attachement à une nation « qui naguère avait promené son drapeau victorieux dans toutes les capitales du continent » et l’idée selon laquelle le gallicanisme a contribué à une double catastrophe, pour la papauté et pour la France[12]. Isolement doublement fatal, donc, que celui qui permettait aux « païens » de l’emporter à Romme comme à Paris. Le lien que la Commune exalte entre résistance patriotique et révolution – une révolution caractérisée notamment par l’anticléricalisme – ne doit pas faire oublier qu’existe aussi un lien durable entre patriotisme catholique et tradition contre-révolutionnaire.
Aucun de ces deux liens n’aidait la France à sortir de l’isolement, le premier parce qu’il entretenait la crainte de l’hydre révolutionnaire toujours renaissante – le frère d’Anna Karénine, Stépane Arkadievitch, en retrouve le thème dans le journal libéral auquel il est abonné -, le second parce qu’il associait à la défense nationale celle du pouvoir temporel du pape alors que celui-ci ne pouvait plus guère espérer trouver un Europe d’autre champion. L’éventualité de voir la France embrasser la cause du pape au risque d’une nouvelle guerre a pu être utilisée comme argument électoral par les républicains contre le gouvernement d’Ordre moral du maréchal de Mac-Mahon après « l’alerte de 1875 », comme le reconnaît Joseph Reinach[13]. Proche de Gambetta, celui-ci savait mieux que personne que, quelques années plus tard, c’est contre Gambetta lui-même que la menace de guerre fut agitée dans la lutte électorale. Dans l’intervalle, la situation politique avait changé, les opportunistes s’étaient installés au pouvoir et, désireux de sortir du « recueillement » qui avait suivi les désastres de 1870-1871 – de montrer, disait Joseph Reinach, que « la République n’était pas une tente pour le sommeil[14] »-, ils avaient renoué avec la politique d’expansion coloniale.
Le temps de l’impérialisme
L’un des premiers Français à employer le mot « impérialisme » a été Georges Clemenceau[15]. On sait avec quelle vigueur il s’est opposé à la politique coloniale de Jules Ferry. Son article du 25 mars 1900, « L’épidémie d’impérialisme », fait étrangement écho au discours de Disraeli. Après avoir constaté que « le talon de Bismarck invaincu demeure sur l’Europe » et reconnu que l’Angleterre avait froissé l’amour-propre national – le souvenir de Fachoda était encore cuisant-, il affirme : « L’Angleterre demeure la plus grande puissance libérale, et, notre première irritation calmée, il faudra bien reconnaître que l’Angleterre ne peut décroître qu’au profit de la Russie et de l’Allemagne, qui représentent tout autre chose dans le monde que le droit et la liberté[16] . »
Il importe ici de rappeler avec Christopher Clark que, pour Disraeli, la première conséquence de la guerre franco-allemande est que la Russie en a profité pour dénoncer le traité de 1856, qui avait mis fin à la guerre de Crimée et restreint ses droits dans la mer Noire[17]. Elle a ainsi tiré profit de sa neutralité bienveillante envers la Prusse, non sans prendre de vitesse Bismarck, qui proposa la tenue d’une conférence internationale. Celle-ci eut lieu à Londres dès le 17 janvier 1871. Si elle satisfait la revendication russe de la liberté de navigation en mer Noire, la Convention finale est précédée d’un Protocole qui réaffirme l’impossibilité de se délier unilatéralement d’engagements contractés dans le cadre du concert européen. Le duc de Broglie, qui représenta la France à la dernière séance, le 13 mars, rappela la « règle salutaire » selon laquelle aucun changement important ne devait être introduit dans les relations internationales sans l’accord de tous les membres de ce qu’il appelait « la famille européenne[18] ». Invitée à participer in extremis à la construction d’un nouvel ordre international, rendue nécessaire par son amoindrissement, la France était ainsi contrainte d’afficher sa fidélité aux règles adoptées, à la suite de sa défaite déjà, en 1814-1815.
Si le congrès de Paris de 1856 avait marqué son retour au premier rang dans le « système européen[19] », la formule des conférences devait illustrer désormais le transfert à l’Allemagne de la primauté diplomatique sur le continent en même temps que le maintien de la primauté mondiale de l’Europe. Au congrès de Berlin de 1878, William Waddington, ministre des Affaires étrangères du dernier gouvernement de la présidence Mac-Mahon, plaida avec succès en faveur de la Grèce et revendiqua pour la France une part dans le règlement des affaires méditerranéennes. C’est le point de départ de l’établissement du protectorat sur la Tunisie, auquel trouvèrent avantage aussi bien l’Angleterre, soucieuse de développer librement son influence en Egypte, que l’Allemagne, prête à encourager les projets d’expansion de la France puisqu’ils éloignaient et dispersaient ses forces en Afrique et en Asie. L’ambassadeur d’Allemagne à Paris précise dans ses mémoires que Bismarck était même prêt à la laisser s’adjuger le Maroc. Commentant ce témoignage en 1909, Henri Welschinger se plaît à souligner que son successeur Bülow n’a pas eu la même opinion[20].
L’évolution des alliances en Europe et la volonté de Guillaume II de mener une « politique mondiale » [Weltpolitik] avaient changé l’équilibre des forces. La retraite de Bismarck a été bientôt suivie de la fin du système diplomatique qui lui avait permis de maintenir la France dans l’isolement. Et c’est encore en Europe orientale que se situe le principal tournant. La Russie et la Prusse avaient eu jusqu’alors intérêt à s’entendre pour contenir le nationalisme polonais. C’est dans ce but avoué que Bismarck avait lancé le « combat pour la civilisation » [Kulturkampf]. En France, depuis 1830, la polonophilie avait en quelque sorte continué le philhellénisme et illustré à sa manière l’ambivalence déjà relevée entre le catholicisme et la Révolution. Lacordaire aussi bien que Proudhon avaient soutenu la cause polonaise, certes pour des motifs et avec des arguments différents[21]. Des Polonais ont combattu du côté français en 1870 puis pour la Commune. Louise Michel signale dans ses souvenirs la mauvaise réputation qu’avaient les polonais chez les officiers versaillais[22], tandis que la presse nationale-libérale allemande suggérait en 1871 que, « depuis 1848, les Polonais, en Europe, avaient toujours été sur toutes les barricades[23] ». Pour le gouvernement républicain, rechercher l’alliance russe signifiait donc renoncer à ce qui, en somme, était relégué désormais au rayon des vieux rêves humanitaires.
Si des contacts militaires sont attestés dès les lendemains de la défaite française de 1871, un ensemble de facteurs, de l’affaire Schaebelé au refus opposé par l’Allemagne à la Russie de renouveler en 1890 le Traité de réassurance du 18 juin 1887, explique que le rapprochement franco-russe ait abouti à la convention militaire signée le 17 août 1892. Alliance idéologiquement improbable, que la gauche française ne cesse de critiquer, mais alliance jugée militairement indispensable pour les deux parties, plus encore après la guerre russo-japonaise de 1904-1905, dont l’issue fait mesurer à la France le risque que comporterait pour elle un durable affaiblissement de l’armée russe, conc l’urgence d’aider à son redressement. La difficulté principale était dès lors de faire converger cette alliance militaire et l’entente avec le Royaume-Uni scellée en 1904, tant le « grand jeu » en Asie prenait encore le pas sur la crainte du déséquilibre en Europe à l’avantage de l’Allemagne[24]. On sait comment devait évoluer l’Entente et l’on mesure mieux ainsi le chemin parcouru depuis les spéculations de Disraeli sur les conséquences de la guerre franco-allemande.
Elie Halévy a présenté dans ses célèbres conférences d’Oxford, en 1929, son interprétation de « la crise mondiale de 1914-1918 », qui fut d’abord une guerre, en 1914, puis, en 1917, une révolution. En vérité, le lien entre guerre et révolution apparaît constant depuis les révolutions de la fin du XVIIe siècle, du fait même de leur caractère d’affirmation nationale, outre-Atlantique comme en France puis en Europe-et cela suffit pour réfuter l’idée selon laquelle la période comprise entre 1814-1815 et 1914 aurait été, à quelques nuances près, une ère de paix. Mais on ne peut s’en tenir à cette observation générale. Nous avons constaté que dans le même temps existe toujours la possibilité d’une dissociation entre le nationalisme et la révolution sociale – donc la possibilité que la guerre, instrument de la politique nationale, soit aussi un moyen de conjurer voire de briser le risque de subversion de l’ordre établi. Elie Halévy l’avait bien compris, qui distinguait ces deux sources possibles d’un conflit général avant 1914, le nationalisme et le socialisme, et soulignait que l’action du « principe révolutionnaire des nationalités » dans l’Empire austro-hongrois avait été bien plus déterminante que celle des « forces qui travaillaient à la révolution[25] ». C’est précisément dans cette perspective qu’il faut évaluer l’importance des deux principaux résultats de la guerre de 1870-1871, la mise en place du Reich wilhelminien et l’écrasement de la Commune de Paris, non seulement dans l’histoire des relations franco-allemandes mais aussi dans l’histoire mondiale.
[1] Cucheval-Clarigny, 1871.
[2] D. Halévy, 1941.
[3] Benjamin Disraeli, discours du 9 février1871 à la Chambre des communes : http://hansard.millbanksystems.com/commons/1871/feb/09/adress-to-her-majesty-on-her-most#S3Vo2o4Po_18710209_HOC_17. Traduction de l’auteur.
[4] Cat. exp. Le Ray-Burimi, Peiteau, Maffioli, 2011.
[5] Pécout, 2004.
[6] Voir notamment le colloque Cavour l’Européen et la « révolution diplomatique », tenu à Paris les 9 et 10 décembre 2010 sous la direction scientifique de Roberto Balzani et Gilles Pécout. Voir aussi Gall, 1984.
[7] Jaurès, 2012, p. 118.
[8] Krumeich, 2013, p. 77-88. Andler, 1918. Candar, 2004, p. 49-55. Lindeperg, Maso, Becker, 2015.
[9] Revel, 1998, p. 11-25.
[10] Lettre à sa nièce Valentine de Cessiat, avril-mai 1848 : Lamartine, 1996, p. 14-15.
[11] Cité par Welschinger, 1911, p. 150. La préface de cet ouvrage, publié peu avant L’Armée nouvelle, offre un intéressant témoignage du sens qu’il y avait à vouloir faire la lumière sur les conditions du déclenchement de ce conflit à la veille de la crise d’Agadir.
[12] Gaume, 1871, p. 54, 64, 96.
[13] Reinach, 1921, p. 38.
[14] Ibid., p. 44.
[15] Duroselle, 1988, p. 526
[16] Georges Clemenceau, « L’épidémie d’impéralisme », La Dépêche, 25 mars 1900. Voir Mailhos, Pech, 2013, p. 385-386.
[17] Circulaire du prince Gorchakov, 19 au 31 octobre 1870, Revue générale, 6e année, nouvelle série, t. II, 1870, p. 678-680. Voir Clark, 2013, p. 147.
[18] Gustave Fagniez, son successeur en 1901 à l’Académie des sciences morales, le rappelle dans sa « Notice sur la vie et les travaux de M. le duc Albert de Broglie », Mémoires de l’Académie des sciences morales et politiques, t. XXIV, 1904, p. 191. Voir aussi Distefano, 2004, p.89.
[19] Soutou, 2009, p. 13-26. Voir aussi Soutou, 2014.
[20] Henri Welschinger, « Les mémoires du prince Clovis de Hohenlohe », II, Revue des deux mondes, septembre-octobre 1909, p. 613.
[21] Duval, 1989, p. 419-429. Ferretti, Castleton, 2016.
[22] Michel, 1898, p. 292-293.
[23] Die Grenzboten, cité par Goyau, 1911, p. 175.
[24] Korobov, 2006.
[25] E. Halévy, 1938, p. 181, 189.
Articles récents
Communiqué du Président Général
Dégradation de la statue du Général Joseph de Goislard de Monsabert Crédit photo : Arnaud Brukhnoff Dans la nuit du mardi 23 au mercredi 24 juillet, le buste du Général Joseph de Goislard de Monsabert, Compagnon de la Libération, a été vandalisé, descellé et mis volontairement à terre, place des Martyrs de la Résistance, à […]
Voir l'article >Il était une fois un monument
Le monument aux sportifs « Morts pour la France » Monument aux sportifs « Morts pour la France », Stade de France Au niveau de la porte S du Stade de France, apparaît un impressionnant et imposant enchevêtrement de poutres d’acier posées sur un socle. On peut y lire cette inscription Aux sportifs morts pour […]
Voir l'article >Bilan des activités du Président Général
En juin 2024 Samedi 1er juin : Je suis intervenu à l’Assemblée générale de la Fédération Française de Généalogie à la demande de son nouveau président, Francis Chassagnac. J’ai rappelé la convention de partenariat signée entre nos deux associations en juillet 2020. Cette convention qui s’inscrivait dans le lancement du 150ème anniversaire de la guerre de […]
Voir l'article >