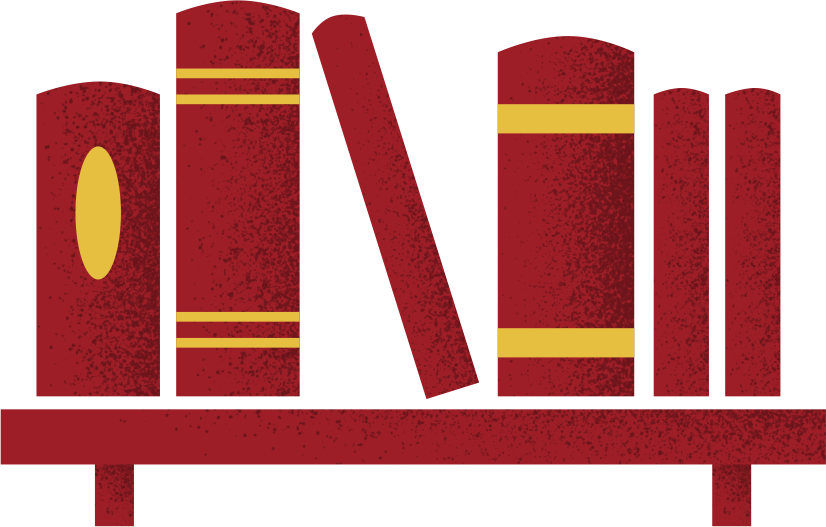CHRONIQUE D’UN DÉSASTRE ANNONCÉ

Éric Anceau enseigne l’histoire politique et sociale de la France et de l’Europe contemporaines à Sorbonne Université. Spécialiste reconnu de la Deuxième République, du Second Empire et des débuts de la Troisième République, il a publié vingt-cinq ouvrages. Dans le dernier, Les Élites françaises des Lumières au grand confinement (Passés Composés, 2020), il montre, entre autres, que le traumatisme de la débâcle de 1870 a entraîné une profonde remise en cause des élites, une volonté d’améliorer leur formation et de les renouveler.
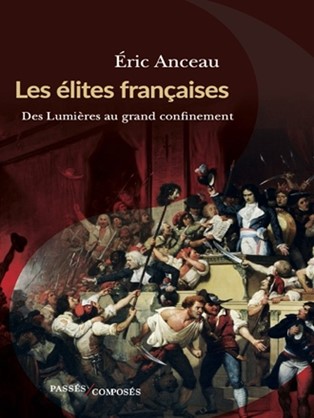
Malgré sa brièveté (moins de dix mois de juillet 1870 à mai 1871, dont six seulement de combats), la guerre franco-allemande dont nous commémorons cette année le 150e anniversaire est l’un des épisodes les plus douloureux de l’histoire de France. À la suite de la capitulation de Napoléon III à Sedan et de la révolution du 4 septembre 1870, les républicains qui succèdent alors au pouvoir au Second Empire auraient pu renoncer à poursuivre une guerre très mal engagée en en rejetant toute la responsabilité sur le souverain renversé qui l’avait déclarée. Ils font pourtant le choix de poursuivre la lutte, en raison des exigences du chancelier Bismarck jugées exorbitantes par le ministre des Affaires étrangères français, Jules Favre, lors de l’entrevue de Ferrières des 19 et 20 septembre 1870. Le mythe révolutionnaire de l’an II du renversement d’une situation compromise par l’élan patriotique et républicain joue à plein. Cependant, la République n’est pas plus heureuse que l’Empire.
Alors que Paris est encerclée par les armées allemandes depuis la mi-septembre, le ministre de l’Intérieur, Gambetta qui s’est échappé en ballon, le 7 octobre, rejoint Tours où s’est installée une délégation du gouvernement. Il s’empare du ministère de la Guerre et donne une impulsion énergique à la défense nationale, avec pour but de libérer la capitale, grâce à de nouvelles armées venues de l’intérieur : une formée sur la Loire et confiée à Louis d’Aurelle de Paladines, une autre dans le Nord sous Bourbaki puis sous Faidherbe, et une dernière dans les Vosges puis en Bourgogne, sous Garibaldi venu se mettre au service de la France avec ses deux fils et son gendre. Cependant, le 27 octobre, la capitulation de Bazaine à Metz où la plus belle armée française était enfermée depuis la mi-août est un désastre. En effet, elle libère l’armée prussienne du prince Frédéric-Charles qui gagne la vallée de la Loire. Si Aurelle de Paladines l’a emporté à Coulmiers, le 9 novembre, il se voit désormais barrer la route de Paris, à Beaune-la-Rolande, trois semaines plus tard et doit se replier sur Orléans. Face à un ennemi supérieur en nombre, la ville doit être abandonnée, comme Tours, et la délégation gouvernementale est contrainte de se replier sur Bordeaux. Gambetta démet Aurelle de Paladines et son armée est divisée en deux. L’une des nouvelles armées est confiée au général Chanzy qui reçoit pour mission d’attirer les Allemands vers l’Ouest, l’autre au général Bourbaki, chargé de libérer Belfort assiégée depuis le 3 décembre.
À l’Ouest, Chanzy est battu à la bataille du Mans, les 11 et 12 janvier 1871. Quant à Bourbaki qui ne parvient pas à faire sa jonction avec Garibaldi, fixé autour de Dijon, il est d’abord victorieux à Villersexel, le 11, mais il ne peut percer les lignes allemandes lors des batailles d’Héricourt et de la Lizaine, livrées à proximité de Montbéliard du 15 au 17 janvier. La retraite dans le froid tourne au fiasco au point que Bourbaki envisage pendant un temps le suicide. Les débris de son armée passent en Suisse pour ne pas tomber aux mains de l’ennemi et y sont internés. Cet épisode douloureux que relate le panorama Bourbaki de Lucerne marque la fin de tout espoir à l’Est.
Au Nord, le sort des armes n’est pas plus favorable et les espoirs de voir Faidherbe libérer Paris s’évanouissent au même moment. Il a déjà dû renoncer à faire sa jonction avec le corps d’armée qui protège Rouen et qui est finalement lui-même contraint de se replier sur Le Havre et n’est pas parvenu à secourir Péronne, à la suite de la bataille de Bapaume du 3 janvier 1871. Alors qu’il a déjà du mal à protéger le bassin houiller et la région lilloise de l’ennemi, il reçoit l’ordre d’agir pour briser le siège de Paris. Sa défaite à Saint-Quentin, le 19 janvier, marque la fin de cet espoir.
À ce moment-là, la situation de Paris est désespérée. Rien ne laissait supposer un dénouement si rapide quatre mois plus tôt. Lorsque les armées allemandes étaient arrivées sous Paris, le 19 septembre, elles avaient trouvé face à elles un grand camp retranché. Depuis un quart de siècle, la ville était protégée par 33 km de fortifications et par une ceinture de 16 forts. En outre, le gouvernement impérial avait fait venir, par précaution, du bétail et des vivres des campagnes environnantes, au cours du mois d’août. Mais, par la suite, la situation s’est vite dégradée. Si l’approche de l’ennemi a provoqué l’exode en province de près de 100 000 bourgeois, 200 000 banlieusards ont fait le chemin inverse pour se protéger et plus de 100 000 soldats sont venus de province pour défendre la capitale, les seuls militaires expérimentés parmi ses 525 000 défenseurs, portant la population parisienne à un plus haut historique de 2 005 000 habitants. Il devenait évident qu’un long siège allait poser le problème des vivres. Plusieurs tentatives de sorties en force voulues par le général Trochu, à la fois chef du gouvernement et gouverneur militaire de Paris, ont échoué et amené une partie des Parisiens à accuser leurs dirigeants d’incompétence. Périodiquement, des rumeurs de victoires ont ramené l’espoir avant d’entraîner un accablement et une colère plus forts encore lorsqu’elles se sont évanouies devant des défaites bien réelles. Le 31 octobre, une foule dirigée par quelques meneurs a pris l’Hôtel de Ville et fait prisonnier le gouvernement. Libéré grâce à l’énergie de la garde nationale, celui-ci a cependant dû accepter des élections qu’il s’était refusé à accorder jusque-là, partie par crainte de les perdre, partie pour ne pas donner à l’ennemi le spectacle de luttes intestines. S’il a été conforté dans ses fonctions par un plébiscite préalable et si ses candidats l’ont emporté dans douze des vingt arrondissements, ce qui a permis à l’un de ses membres, Jules Ferry, de devenir maire de Paris, les huit arrondissements peuplés et populaires du nord-est ont été gagnés par des radicaux et des révolutionnaires.
Début novembre, les stocks de vivres se sont amenuisés et les premières pénuries se sont fait sentir. Les queues se sont allongées devant les boulangeries et les boucheries. Les aliments ont dû être rationnés. Depuis le 26 octobre, les boucheries municipales n’ont plus distribué que 50 grammes de viande par personne et, quatre jours plus tard, elles ont été contraintes de remplacer la viande par du suif. Le maire de Paris y a gagné un surnom : « Ferry-Famine ». Les Parisiens en sont venus à manger leurs animaux de compagnie, chiens et chats, mais aussi des moineaux ou encore des rats vendus deux francs pièce sur un marché spécifique, place de l’Hôtel de Ville. Ne parvenant plus à nourrir ses animaux, le Jardin des Plantes a commencé à les vendre à la « Boucherie anglaise » du boulevard Haussmann. Les 29 et 30 novembre, les éléphants Castor et Pollux ont été les derniers à être sacrifiés. Cette « viande de fantaisie » comme on l’appelle, est vendue très cher et réservée aux plus riches des Parisiens.
Depuis Tours, Gambetta poussait sans cesse Trochu à tenter de nouvelles sorties. Du 30 novembre au 2 décembre, a eu lieu la grande percée de Champigny. Comme les précédentes elle a échoué. Une autre sortie massive au Bourget, le 21 décembre, n’a pas été plus heureuse. Aux restrictions alimentaires et à tous ces échecs que la propagande gouvernementale cherchait vainement à minimiser, s’ajoutait le froid. En décembre, la température a oscillé entre – 5 et – 20° C et la Seine a été gelée près de trois semaines. Le bois et le charbon sont venus à leur tour à manquer. Des artistes ont édifié un bonhomme de neige aussitôt surnommé « le résistant » et qui a ému les Parisiens.
Si quelques restaurants, ont proposé des menus gastronomiques pour Noël, comme le Café Voisin de la rue Saint-Honoré, avec parmi les plats, une tête d’âne farcie, un consommé d’éléphant, un chameau rôti à l’anglaise, un civet de kangourou, des côtes d’ours, un cuissot de loup sauce chevreuil, un chat flanqué de rats, une terrine d’antilope aux truffes, le tout copieusement arrosé de Château Palmer, de Mouton-Rothschild, de Romanée Conti, de Bellenger frappé et de Grand Porto, car les caves sont demeurées bien remplies, seuls les plus fortunés ont pu en bénéficier. Le commun des mortels a commencé de plus en plus à souffrir. Le beurre a atteint alors 30 francs le kilo, le chat 20, le corbeau 5, la livre de chien 4, le rat 3, alors qu’un ouvrier servant dans la garde nationale touchait 1,5 franc par jour et son épouse, s’il en avait une, 0,75 franc. Beaucoup de Parisiens en sont désormais réduits au « pain de siège » confectionné à partir de riz, d’avoine et de paille. La sous-nutrition et la mal nutrition ont fait leurs premières victimes.
Le roi de Prusse, Guillaume, qui répugnait jusque-là au bombardement de Paris, car il craignait que sa réputation n’en souffrît, s’est laissé convaincre par Bismarck qu’il s’agissait sans doute du meilleur moyen de hâter la fin de la guerre. Après le pilonnage intensif des forts, à partir du 27 décembre, le bombardement quotidien de la capitale a commencé le 5 janvier 1871. Plus de mille maisons et cent édifices publics, pour l’essentiel sur la rive gauche, ont été détruits ou endommagés en quelques jours, dont le Muséum, le palais et le musée du Luxembourg, les dômes du Panthéon et de la Sorbonne, le Val-de-Grâce et l’église Saint-Sulpice.
Si ces bombardements ont fait moins de 400 morts car les Parisiens ont vite pris l’habitude de se réfugier dans les caves dès leur commencement, et s’ils n’entrent que pour une petite part dans l’excédent de 42 000 décès par rapport à la même période de l’année précédente, car ceux-ci sont principalement dus à la disette et au froid, ils ont tendance à provoquer la colère plus qu’ils n’émoussent la volonté de résistance, car sont touchés un grand nombre de femmes, d’enfants et de malades des hôpitaux et des hospices.
C’est bien l’échec des armées de secours au Sud, à l’Est et au Nord qui décide de l’issue de la guerre. Lorsque parviennent à Paris la nouvelle des défaites du Mans et de la Lizaine, l’armistice est envisagé mais, devant le risque d’une insurrection des « rouges » qui, le 6, ont de nouveau réclamé l’instauration d’une Commune, une ultime tentative de sortie est décidée sur le plateau de Saint-Cloud, à Buzenval et dans les bois de Saint-Cucufa. Le 19, jour de la bataille de Saint-Quentin qui a aussi pour objectif de provoquer une diversion, 90 000 hommes soutenus par l’artillerie du mont Valérien passent à l’attaque. D’abord surpris, les Allemands se ressaisissent et repoussent l’assaut en quelques heures. Plus de 4000 soldats français périssent dans cette débâcle. Trochu est contraint de céder le commandement militaire au général Vinoy.
Seul Gambetta est désormais décidé à poursuivre la lutte. Le gouvernement se résigne à négocier avec l’Allemagne. Alors que le chef d’état-major général de l’armée allemande, Moltke, souhaite, lui aussi, poursuivre la guerre jusqu’à la capitulation sans condition des Français pour pouvoir leur imposer des conditions de paix très dures, Bismarck parvient à convaincre son roi qu’il faut ménager l’avenir maintenant que l’essentiel est acquis : la victoire est désormais certaine et l’Empire allemand vient d’être proclamé dans la galerie des Glaces du palais de Versailles, le 18 janvier 1871, au profit de son roi. Le 23, il accueille le ministre des Affaires étrangères, Jules Favre par un terrible : « Je vous attendais », suivi d’un railleur : « Vous avez vieilli ». Ils vont en effet reprendre leurs discussions là où ils les avaient laissées, quatre mois plus tôt, à Ferrières. Favre avait alors déclaré : « Nous ne céderons pas un pouce de notre territoire, ni une pierre de nos forteresses ». On en n’est plus là. Le gouvernement républicain sait que la France devra renoncer à l’Alsace et à une partie de la Lorraine, acquitter une lourde indemnité de guerre et subir une occupation, mais qu’il ne peut faire autrement que d’accepter ces conditions très dures. Un armistice de vingt et un jours renouvelables est signé le 28 janvier.
Bismarck souhaite aussi la tenue rapide d’élections législatives pour conclure la paix avec un pouvoir régulier. Gambetta qui veut reprendre le combat, qui entend influer sur les élections et qui refuse aux serviteurs de l’Empire le droit de se présenter, est poussé à la démission par ses collègues le 6 février. Deux jours plus tard, les Français votent dans des conditions très particulières puisqu’un tiers du territoire est occupé, de nombreux soldats, prisonniers de guerre et réfugiés ne peuvent participer au scrutin, et aucune campagne n’a pu avoir lieu. Ils font massivement le choix de candidats favorables à la paix, sauf dans les départements de l’Est.
L’Assemblée nationale se réunit au Grand Théâtre de Bordeaux dès le 13 et confie à Thiers les fonctions de chef de l’exécutif provisoire avec mandat de négocier les préliminaires de paix avec Bismarck. Ceux-ci sont conclus le 26 février, à Versailles, puis ratifiés par l’Assemblée. Comme on le redoutait, ils imposent à la France la perte de l’Alsace et d’une partie de la Lorraine, une indemnité de guerre gigantesque de 5 milliards de francs or et l’occupation de plusieurs départements de l’Est tant qu’elle ne sera pas acquittée. Le traité de Francfort signé le 10 mai 1871, par Jules Favre, reprend les principales clauses des préliminaires. La France obtient simplement de conserver Belfort, en raison de sa résistance héroïque, en échange de 12 communes supplémentaires en Lorraine. Le peuple de Paris qui s’est soulevé et a proclamé la Commune, est écrasé quinze jours plus tard.
Le conflit qui s’achève n’a pas seulement remplacé l’Empire par la République, il modifie aussi l’équilibre européen en faveur du nouvel Empire allemand. La France vaincue, humiliée et amputée, parvient cependant, dès 1873, et contre toute attente, à payer l’indemnité de guerre, ce qui lui permet de se libérer. Les souvenirs de « l’année terrible » mais aussi la douleur occasionnée par les « provinces perdues », n’en nourrissent pas moins un profond ressentiment, lourd de conséquences pour l’avenir.
Éric Anceau
Articles récents
Billet d’humeur du Président Général
La France détient un record mondial ! Le 28 mars 2024, les 78 députés présents dans l’hémicycle ont adopté une proposition de résolution visant à instaurer une journée de commémoration pour les victimes du massacre du 17 octobre 1961 à Paris. L’histoire en est connue. Ce jour-là, la répression policière d’une manifestation pro FLN bravant le […]
Voir l'article >Sous les projecteurs
Afin de mettre en lumière la Guerre d’Indochine et la bataille de Dien Bien Phu, le Souvenir Français a accepté de s’associer à plusieurs associations dans un groupe dénommé « l’Alliance Indochine 2024 », coordonné par l’ASAF (Association de Soutien à l’Armée Française) Cette alliance regroupe les associations suivantes : – Association nationale des Anciens Prisonniers Internés Déportés […]
Voir l'article >Monument du mois
Le cimetière de Than Muoi / Dong Mo 2000 : Cimetière de Dong Mo et ses 81 tombes en ruines, découvertes par le colonel Platon, Délégué Général du Souvenir Français. Le cimetière de Than Muoi / Dong Mo est un lieu exceptionnel. D’abord par son histoire, Profitant de la faiblesse de la France après la […]
Voir l'article >