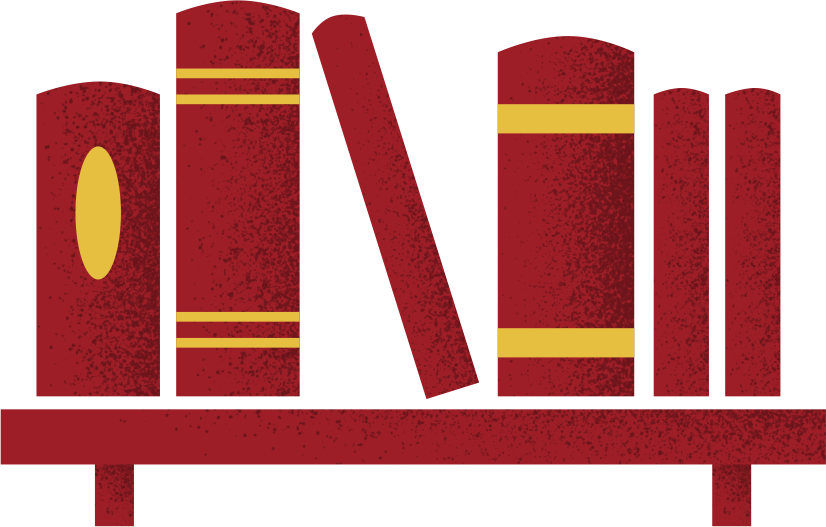Jean-Pierre Bois
Professeur émérite des Universités,
Président de l’Académie des Sciences, Belles-Lettres et Arts d’Angers.
Ancien élève de l’Ecole normale supérieure de Cachan, agrégé de l’Université, docteur ès-lettres. Professeur émérite de l’Université de Nantes où il a dirigé le Centre de Recherches en Histoire Internationale et Atlantique, spécialiste d’histoire militaire et histoire des relations internationales. Auteur de nombreux ouvrages dont les plus récents sont : La Paix, histoire politique et militaire (1435-1878), Paris, Perrin, 2012 (Prix Drouyn de Lhuys, Académie des Sciences morales et politiques, 2012) ; La Fayette, entre révolutions et modérations (Perrin, 2015), Premier prix du salon du Livre de Verdun, L’abbé de Saint-Pierre, entre classicisme et Lumières, Champvallon, 2017, Prix de la biographie historique de l’Académie française, 2018.
Le 14 juillet 1919
Le 14 juillet 1919, à l’occasion de la fête nationale, voit à Paris le plus grand défilé militaire de l’histoire de la France : la Fête nationale prend ce jour une dimension mondiale, tant par le nombre des hommes qui défilent sur les Champs-Elysées et par le nombre des Etats représentés, que par sa portée morale.
La Grande Guerre y est incarnée – « Grande Guerre », c’est l’expression du temps, ou parfois la « der des ders » ; on ne parle de la « Première Guerre » que vingt ans plus tard. L’armistice du 11 novembre 1918 est encore récent – huit mois seulement ; la paix plus encore : le traité de Versailles vient d’être signé le 28 juin, date choisie afin de rappeler l’assassinat de l’archiduc François-Ferdinand le 28 juin 1914. Le traité n’est d’ailleurs signé qu’avec l‘Allemagne : ce 14 juillet 1919, c’est la guerre franco-allemande qui s’achève, dans ce défilé qui consacre la suprématie mondiale de la France – au moins sa suprématie militaire. Mais beaucoup plus encore, et plus qu’un simple défilé de vainqueurs, il est l’incarnation de « la Victoire » qui, jusqu’à cette date, était encore pour beaucoup, selon l’expression de Robert de Flers, « éparse, diffuse, abstraite ».
La fête nationale a trois temps. Le premier, dans la nuit du 13 au 14, une retraite aux flambeaux, un temps de recueillement, la veillée d’honneur à l’Arc de Triomphe. Le troisième, le 14 juillet au soir, est le temps de l’illumination, des bals, des feux d’artifice. Dans la matinée du 14 juillet, le deuxième temps est le défilé triomphal des troupes alliées et françaises, de la Porte Maillot à la place de la République, en passant sous l’Arc de Triomphe et en descendant l’avenue des Champs-Elysées pavoisée. Les armées victorieuses défilent devant les victoires aux ailes déployées qui consacrent la formidable épopée et la résument en quelques noms tragiques : la Champagne et les Eparges, la Somme, la Marne, l’Argonne, l’Aisne, et avec les bas-reliefs des autels des cités martyres de la place de la Concorde, Reims, Verdun, Arras, Soissons.
Le 13 juillet au soir, les trois maréchaux ont reçu du Président du Conseil municipal de Paris, Emmanuel Evain, une épée d’honneur : Joseph Joffre, 67 ans, le polytechnicien laïque et franc-maçon, issu du génie, celui qui a évité le désastre en 1914 et pour lequel la dignité de maréchal a été rétablie le 27 décembre 1916 ; Ferdinand Foch, 68 ans, le polytechnicien catholique, artilleur, maréchal à la date du 6 août 1918 ; Philippe Pétain, 63 ans, le fantassin sorti de Saint-Cyr qui achevait sa carrière en 1914 comme colonel du 33ème régiment d’infanterie à Arras, nommé maréchal le 11 novembre 1918. Avec eux, vingt-trois régiments reçoivent des mains de Poincaré la fourragère rouge de la Légion d’honneur. Le soir, Georges Clemenceau se rend au cénotaphe placé sous l’Arc de Triomphe, et s’incline, tête nue. La veillée des morts commence.
Le lendemain le cénotaphe est devant la tribune officielle. La France politique s’y rassemble, en chapeaux hauts de forme : Georges Clemenceau, bien sûr ; Raymond Poincaré, le Lorrain , président de la République, avec son visage blanc, son front dégarni et sa petite barbiche, portant son grand cordon de la Légion d’Honneur ; Aristide Briand, plusieurs fois président du Conseil ; parmi les personnalités quatre futurs présidents de la République – Paul Deschanel alors président du Sénat, Gaston Doumergue, Paul Doumer qui a perdu quatre fils au front, et Albert Lebrun, alors simplement ministre démissionnaire du Blocus et des Territoires occupés ;
A la porte Maillot, les képis. Ferdinand Foch en tunique bleu horizon, Joffre en dolman noir et pantalon rouge prennent la tête du cortège triomphal. Ils sont suivis par la musique du 28ème régiment d’infanterie, et accompagnent un cortège de mille mutilés conduits par l’immense André Maginot, député de la Meuse, volontaire en 1914, amputé d’une jambe. Leur présence rappelle les terribles combats, le bond hors des tranchées, le corps-à-corps à la baïonnette, la course sous la mitraille et les gaz, les hôpitaux sans anesthésie et les convois sanitaires, l’horreur de la guerre que cachaient les communiqués du grand quartier général.
Vient après ce premier passage saisissant, le défilé des troupes alliées, par ordre alphabétique de nation, pour un défilé de trois heures. En tête, John Pershing, impassible, ancien des guerres contre les Indiens et dans les Philippines, celui qui était venu dire à la France, le 4 juillet 1917 : « La Fayette, nous voici ». Les Américains défilent, coude à coude et reçoivent une ovation impressionnante. Puis les soldats belges – ceux auxquels revient toujours le seul qualificatif d’« héroïques », conduits par le général Cyriaque Gillain ; les Britanniques conduits par Douglas Haig, et avec eux tout l’Empire du roi George V, des Canadiens, des Sud-Africains, des Sikhs portant turban, des Australiens et des Néo-Zélandais ; puis, conduits par le général Luca Montuori, les Italiens dont le pas de parade semble un sautillement très inhabituel ; puis les représentants de l’armée grecque conduits par des evzones au pompon rouge, et dont la courte jupe blanche compterait quatre cents plis, autant que d’années passées sous le joug des Turcs ; on applaudit ensuite l’énigmatique général Mara qui mène un groupe de cavaliers japonais, la casquette plate et la jugulaire au menton, accompagnés par un petit détachement d’officiers chinois ; défilent encore les Polonais, les Portugais, les Roumains, une compagnie de Serbes, soldats d’une armée immolée et d’un pays qui n’existe plus ou pas encore, plus tard appelé Yougoslavie après avoir été le royaume des Serbes, des Croates et des Slovènes. Coiffés de casques français, quelques soldats Siamois. Le défilé des nations alliées s’achève avec les Tchéco-Slovaques, représentant une république qui n’existait pas en 1914 et dont la naissance officielle attend encore la signature du traité de Saint-Germain avec l’Autriche, dernier fragment de l’ancien Empire d’Autriche-Hongrie. Tous les uniformes de tous ces pays ont été teintés, au cours de la guerre, d’une même couleur, celle du sang.
Un vide. Un silence impressionnant, une attente : « Et voici les héros de la France ». Ils sont conduits par le maréchal Philippe Pétain, auquel Georges Clémenceau écrit, le soir même, lui transmettant les félicitations du Président de la République, quelques mots simples et d’une immense émotion : « Qui de nous a vu ce jour a vécu ».
Ce qu’ils ont vu, c’est vingt-et un corps d’armées, qui passent sous l’Arc de Triomphe. D’abord les coloniaux – tirailleurs sénégalais et malgaches, goumiers marocains, la nouba des Algériens. Ensuite, les drapeaux de la Légion étrangère, ceux qui portent le plus grand nombre de décorations, avec le légendaire colonel Paul-Frédéric Rollet. Puis les survivants de Dixmude et de l’Yser, les fusiliers marins de l’amiral Pierre Alexis Ronarc’h, seul officier de son rang à défiler à pied. Puis l’artillerie du général Frédéric-Georges Herr, saluée par les cris de « Vive le 75 », « Vive le 155 ». Puis la cavalerie de Saumur, les gardes républicains, les chasseurs d’Afrique. Enfin la marée des fantassins dont on ne peut dire lesquels ont été les plus applaudis : le général Paul Pau ; glorieux mutilé de 1870 venu aux premières heures de la guerre réclamer sa place de doyen à la tête des Saint-cyriens, ou Édouard de Curières de Castelnau qui ne sera jamais maréchal, Emile Fayolle qui ne l’est pas encore, Henri Joseph Eugène Gouraud, Charles Mangin, Jean-Marie Degoutte ? Les capitaines et les lieutenants encore imberbes mais déjà décorés au combat ? Ou tout simplement ces Poilus dont bien peu ont survécu aux hécatombes des mois d’août et septembre 1914, de septembre 1915, du printemps 1916, des offensives de 1917, et de celles de l’été 1918 ?
Tous applaudis, mais aucun n’oublie en ce jour de liesse et de grandeur, la douleur des femmes dont le bras est endeuillé d’un large brassard noir, et de ceux qui se cachent derrière des volets clos de l’avenue triomphale, auxquels ne reste comme souvenir de guerre que le diplôme de la mort au champ d’honneur, remis en reconnaissance de la patrie. A cet extraordinaire défilé manquent les noms qui vont bientôt être gravés sur les trente-six mille pages de pierre des trente-six mille monuments aux morts de la France, et deux maréchaux : Gallieni, l’autre vainqueur de la Marne, mort en mai 1916, maréchal à titre posthume le 7 mai 1921, et Lyautey, le proconsul africain, toujours au Maroc, maréchal en date du 19 février 1921. Manquent enfin les Russes, disqualifiés par une révolution sanglante, odieuse au monde d’après-guerre épris de paix et de liberté.
Il n’est guère possible, autrement que d’un seul mot, de rappeler que chaque ville, chaque commune de France a connu son 14 juillet 1919. Que les fêtes les plus belles ont sans doute été celles d’Alsace et de Moselle, redevenues françaises dès le 11 novembre 1918, et que Strasbourg a été une ville en délire, pavoisée comme jamais dans son histoire, avec toutes ses filles en costume portant la grande coiffe aux ailes noires. Une fête comparable à Metz, la ville où Pétain a reçu son bâton de maréchal, à Lille ville occupée pendant toute la guerre, à Amiens où Poincaré est venu en personne le temps d’une revue le 13 juillet, en l’honneur du 72ème régiment d’infanterie. La fête est différente dans les villes qui n’ont pas connu les combats, mais simplement vu arriver les Américains – Nantes, Bordeaux ; ou des convois de blessés – c’est le cas à Lyon. Des villes qui voient parfois le défilé de nombreux effectifs des troupes alliées – des Britanniques à Marseille, des Américains à Tours, dont le pont de pierre vient de recevoir le nom du président Woodrow Wilson. Mais dans bien d’autres villes, la fête n’a pas reçu les moyens nécessaires, et elles n’ont pas toujours leurs régiments de garnison… C’est le cas d’Angers, où ne défilent que quelques détachements de l’emblématique 135ème Régiment d’infanterie, augmentés d’une poignée de cavaliers du 25ème dragons, et d’éléments du 6ème Génie et du 33ème d’artillerie : « Nous, pauvres provinciaux, nous ne verrons pas le grand défilé de la victoire », écrit le chroniqueur du Petit Courrier, le 12 juillet.
Mais qu’importe : le 14 juillet d’Angers, comme celui de Lille, Bordeaux, Lyon ou Marseille, a été le 14 juillet de Paris.
Articles récents
Nos partenaires
Le Souvenir Français est la plus ancienne association mémorielle en France (création en 1887). Elle n’a qu’une ambition « servir la nation républicaine » en sauvegardant la mémoire nationale de la France. Afin d’atteindre cet objectif, Le Souvenir Français entretient des liens amicaux avec de nombreuses associations qui œuvrent en totalité ou partiellement afin de faire vivre […]
Voir l'article >Une photo et son histoire
Le monument du Souvenir Français d’Yvetot Monument du Souvenir Français à Yvetot. Situé dans la partie haute du cimetière Saint-Louis à Yvetot, en Normandie, le monument aux morts rend hommage aux soldats des armées de terre et de mer originaires des communes du canton d’Yvetot, tombés pour la Patrie. On peut y lire l’inscription : […]
Voir l'article >Journal du Président Général pour janvier 2026
Retrouvez dans cette rubrique les principales actions et déplacements du Président général du Souvenir Français pour le mois passé. Mercredi 7 janvier 2026 La commémoration du 95ème anniversaire des obsèques du Maréchal Joffre à Louveciennes (Yvelines) n’était pas banal. Présidé par le Préfet du département, cette cérémonie marquait la « victoire » juridique obtenue afin d’accéder à la […]
Voir l'article >