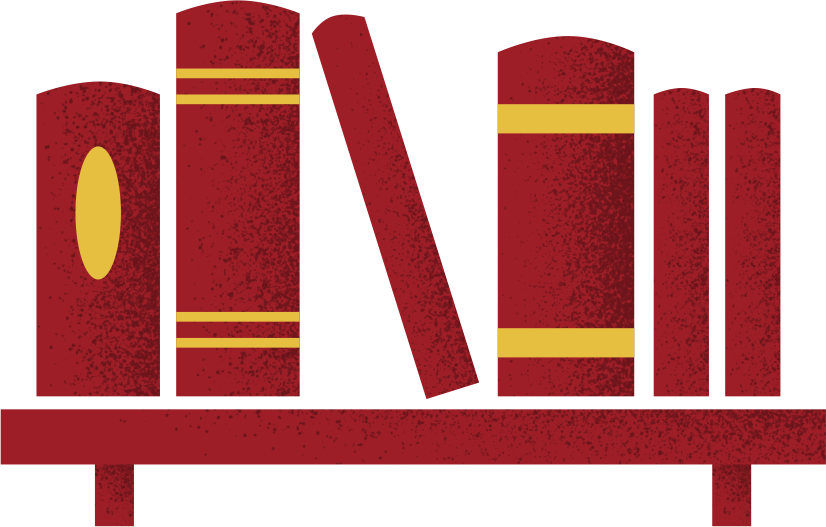Se nourrir pendant la Grande Guerre

Silvano Serventi est historien de la gastronomie. Il est spécialiste des usages alimentaires et des pratiques culinaires. Il est notamment auteur en 2014 de La cuisine des tranchées, l’alimentation en France pendant la Grande Guerre.
Le 10 mars 1917, le journal L’Illustration se risquait à un pronostic sur l’issue de la guerre : « la victoire appartiendra à celui des deux belligérants qui aura, dans ses dernières réserves, un mois de vivres de plus que l’autre ». L’historien Silvano Serventi revient dans cet article, sur un des enjeux fondamentaux du conflit, l’alimentation des soldats. Décryptage.
Le ravitaillement des combattants
La Grande Guerre commença dans le désordre. La mobilisation créa le chaos dans les casernes, dont le nombre était insuffisant pour accueillir tous les appelés. L’intendance fut dépassée par l’ampleur de sa tâche et ne fut même pas en mesure de fournir un uniforme à chaque conscrit. Sans parler du ravitaillement alimentaire des troupes qui semblait hors de portée de ce service de l’armée de terre tant ses moyens et ses procédures étaient en décalage avec les nouvelles réalités. Le système de ravitaillement mis en place montra ses limites dès la mobilisation générale, avec un nombre de repas insuffisant pour satisfaire la masse d’hommes arrivés dans les casernes. Il se révéla encore plus défaillant au cours du transport des appelés vers le Front, et totalement inadapté sur le théâtre des opérations, où l’impréparation de l’intendance apparut au grand jour. Ainsi, au début du conflit, on put voir le bétail réquisitionné, acheminé à pied vers les zones de combats, soit des animaux vivants, considérés en l’espèce comme une réserve de viande sur pieds. Une méthode d’approvisionnement qui avait fait ses preuves au temps des campagnes napoléoniennes mais qui était totalement obsolète pour cette guerre.
Le ravitaillement pendant la guerre de mouvement
Il est vrai que pendant cette brève phase très meurtrière pour les troupes françaises, l’intendance eut à faire face à des problèmes pratiquement insolubles. Comment faire parvenir les denrées nécessaires au repas de centaines de milliers de combattants, alors que les moyens de transport faisaient défaut et que les troupes se déplaçaient constamment ? Certes les animaux vivants pouvaient suivre les unités combattantes en mouvement, mais encore fallait-il trouver un lieu propice à leur abattage ; se procurer les outils pour le dépeçage des carcasses, le nécessaire pour le conditionnement des morceaux de viande et pour leur transport jusqu’aux lieux de distribution. Autant de défis quotidiens qu’il fallait renouveler le lendemain et tous les jours suivants en des lieux différents.
En outre, tous les corps d’armée n’avaient pas le même système de ravitaillement. Les artilleurs bénéficiaient d’un service autonome de cuisine qui leur fournissait un repas quotidien, alors que les fantassins, devaient préparer eux-mêmes leur pitance. La hiérarchie de l’infanterie avait refusé le service autonome de cuisine en vertu de la nécessité de renforcer la cohésion du groupe, laquelle se forgeait avec la corvée de pluche, la cuisson des aliments et le partage du repas préparé en commun dans un esprit de franche camaraderie.
Mais l’esprit de groupe coûta cher aux simples soldats, tant en fatigue qu’en souffrances. Car, en plus de son barda, le fantassin devait transporter le matériel de cuisine qui représentait une surcharge non négligeable pour les longues marches et les manœuvres militaires. En prime, après des journées harassantes de marche où il fallait parfois livrer combat, il lui fallait se mettre en quête de combustible pour la cuisine et préparer son repas avec les moyens du bord s’il voulait manger autre chose que des sardines en boîte ou de la viande en conserve. Encore fallait-il que les denrées arrivent à bon port, ce qui n’était pas toujours possible. Aussi, pour pallier les défections du ravitaillement, les fantassins préféraient dans bien des cas transporter eux-mêmes les produits de base, ce qui surchargeait d’autant leur sac à dos. Leur activité culinaire prit fin avec la bataille de la Marne qui stoppa l’avancée des troupes ennemies et fixa le front sur les lignes acquises par les Allemands. La guerre changea alors de nature.
Le ravitaillement pendant la guerre de position
La guerre des tranchées, qui succéda à la guerre de mouvement, eut raison des dernières résistances des officiers d’infanterie, mais il fallut attendre le début de 1915 pour que le service autonome de cuisine soit opérationnel pour tous les combattants. C’est qu’il fallut tout faire en même temps : bâtir un réseau de cuisines fixes, procurer l’équipement pour les cuisines mobiles, former les brigades de « cuisiniers », et surtout créer les infrastructures d’acheminement et de stockage des denrées alimentaires. La création de ces infrastructures requit des moyens considérables et prit du temps, mais compte tenu de l’ampleur de la tâche l’intendance accomplit une véritable prouesse propre à faire oublier ses failles du début du conflit.
La ration de réserve
Le combattant montait en première ligne avec une ration de réserve à laquelle il ne pouvait toucher que sur ordre de l’officier responsable du secteur. Cette ration journalière était composée de 300 grammes de biscuit, dit « pain de guerre », auxquels s’ajoutaient 300 grammes de viande de conserve assaisonnée, 80 grammes de sucre, 36 grammes de café torréfié, 50 grammes de potage condensé, ou de potage salé et de 6,25 centilitres d’eau-de vie. En février 1916, les autorités militaires décidèrent de compléter cette ration avec 125 grammes de chocolat. Le soldat emportait des rations pour deux jours minimums.
Le soldat des premières tranchées était muni d’un bidon d’eau, d’une contenance d’un ou deux litres. Mais cette quantité, apparemment abondante, pouvait se révéler insuffisante lorsque le ravitaillement ne pouvait être assuré normalement et que les réservoirs installés dans cette zone exposée au feu de l’ennemi étaient percés, voire détruits. De nombreux témoignages de poilus mentionnent d’ailleurs la soif comme la pire des souffrances qu’ils eurent à endurer.
La cuisine des tranchées
Hors des périodes de combats intensifs, des situations difficiles ou des secteurs particulièrement disputés, le combattant des tranchées de l’avant était ravitaillé par les « cuistots », ces cuisiniers improvisés pour les besoins du service et recrutés parmi les réservistes de l’armée territoriale composée des classes antérieures à 1900. Ces hommes de troupe qui, pour la plupart, n’avaient jamais touché une poêle, n’accomplissaient pas vraiment de miracles aux fourneaux. Ils affectionnaient particulièrement les plats en sauce: sautés de mouton, ragoûts de bœuf, bœuf bourguignon, daubes, bœuf bouilli, et naturellement les soupes. En principe, les préparations devaient répondre aux critères de la ration du soldat en campagne, dont la composition se déclinait en 700 g de pain, 300 à 500 g de viande, 100 g de légumes secs et un bol de soupe. Le contenu de la ration pouvait varier selon les disponibilités : viande de veau, de mouton, étaient de bons substituts à la viande de bœuf, tout comme la volaille ou les saucisses … Les pâtes, le riz, remplaçaient les légumes secs, etc. Parmi les vivres des combattants, il y avait beaucoup de conserves de poisson fabriquées en France ou importées d’Espagne et du Portugal, du pâté et autres préparations charcutières en boîte, des fromages, notamment des fromages à pâte dure type gruyère, faciles à conserver et à transporter ainsi que du camembert, qui avait l’avantage d’être conditionné en boîte. L’ensemble devant assurer au soldat en campagne un minimum de 1200 calories par jour. La journée des cuistots commençait à l’aube avec la confection du café que les cuisiniers devaient apporter aux hommes dans la tranchée. Puis ils devaient se rendre aux magasins-dépôts pour prendre les ingrédients du repas. Ensuite il fallait s’atteler à la corvée de pommes de terre ou à la préparation des légumes d’accompagnement, et enfin entreprendre la confection et la cuisson du repas. Pour couronner le tout, ils assuraient le ravitaillement des soldats déployés en première ligne.
La corvée de soupe
Certains cuistots rechignaient à accomplir cette tâche, mais la plupart s’en acquittaient avec responsabilité. En plus d’être épuisante, la livraison de la nourriture aux défenseurs de premières tranchées pouvait se révéler dangereuse. Chargés de boules de pain et de bouthéons, ces grosses gamelles compartimentées et fermées par un couvercle qui servaient au transport des plats cuisinés, le ravitailleur devait parcourir un chemin long et pénible. Il comportait des passages à découvert, des talus éboulés, des trous d’obus transformés en mares boueuses et stagnantes. Parfois le ravitailleur se perdait dans les labyrinthes des tranchées et ne parvenait à destination qu’après des heures d’errance. La corvée de soupe pouvait en outre être prise sous le feu de l’ennemi et il n’était pas rare que certains y laissent leur peau.
Transportés dans ces conditions les repas destinés aux combattants n’arrivaient pas toujours intacts à leurs destinataires. Le pain qui était en forme de couronne pour faciliter son transport, était enfilé sans aucune protection sur un bâton et porté à l’épaule. Mais, le long du parcours, le pain se souillait de terre et de boue en frottant contre les parois humides des tranchées et le soldat auquel il était livré devait retirer une bonne couche du pourtour de la miche pour éliminer le plus gros des souillures de boue. Les bouthéons ne résistaient pas toujours aux chutes du ravitailleur et leur contenu se mélangeait ou, pire, se déversait en partie ou totalement dans la mare boueuse. Le soldat n’avait alors pas d’autre recours que de demander à puiser dans sa ration de réserve, ce qu’il n’était pas assuré d’obtenir.
Les repas au campement
Après les dures conditions de vie dans les tranchées, le soldat vivait son temps de repos au cantonnement comme une véritable période de récréation. Réunis en petits groupes de copains, ils oubliaient vite les privations des premières lignes en s’offrant de bons gueuletons plus ou moins arrosés de vin. Ils avaient à disposition les denrées fournies par l’intendance dont la gamme s’était élargie et étoffée à partir de 1915. Mais les poilus de 14 – 18, qui en grande majorité étaient des paysans, ne manquaient pas d’astuces pour améliorer leur ordinaire. Certains soldats rompus aux pratiques du braconnage savaient piéger le petit gibier. Il n’était pas rare qu’un lapin de garenne ou un lièvre cuit sur une broche improvisée, agrémente le repas. D’autres s’arrangeaient pour faire frire les poissons qu’ils parvenaient à attraper avec des moyens rudimentaires dans les cours d’eau qui coulaient à proximité. D’autres encore partaient explorer les champs des environs en quête de pissenlit, de mâche ou tout autres herbes comestibles. Telle escouade envoyée dans un hameau fort tranquille se la coula douce pendant une vingtaine de jours en se gavant d’omelettes aux pissenlits. À tel poste sanitaire, on profitait d’un long moment d’accalmie pour se lancer dans des essais culinaires avec au menu grillades, patates sous la cendre et chocolat épais au lait condensé en dessert. Tout cela naturellement arrosé de vin et couronné de café puis de pousse-café, soit une bonne rasade de gnôle.
Le vin
Le vin était un élément essentiel de ces repas festifs improvisés. L’armée se montra généreuse sur la distribution de vin car les chefs militaires avaient compris que cette boisson contribuait puissamment au maintien du moral des troupes. Paradoxalement, l’Etat major n’avait pas pensé intégrer le vin à l’ordinaire des soldats et ce furent les viticulteurs du Midi qui créèrent les conditions de l’abondance de vin sur le Front en offrant aux armées 200 000 hectolitres de vin à l’automne 1914. Constatant l’enthousiasme que ce geste avait suscité dans les rangs des soldats, le ministre de la Guerre décida de généraliser et de pérenniser la distribution gratuite de vin aux troupes. La ration fut d’abord limitée à un quart de litre par soldat et par jour, mais elle doubla en 1916, puis fut portée à trois quarts en 1918. Sans compter les quantités de vins que les soldats se procuraient par leurs propres moyens et surtout les distributions gratuites supplémentaires qu’ils recevaient avant de partir à l’attaque, supposées atténuer la perception du danger et leur permettre de juguler la peur.
Convivialité et partage
Mais la plus grande ressource pour les plaisirs gourmands des poilus au repos provenait des colis que les soldats recevaient de leur famille ou de leur marraine de guerre. Ce conflit interminable vit arriver sur le Front des millions de colis provenant de tous les territoires français. Pour la plupart ces colis contenaient des confections alimentaires familiales, des produits locaux ou des spécialités régionales, et le destinataire du colis était heureux de les partager avec ses camarades de l’escouade. Tel soldat originaire du Sud ouest recevait du confit d’oie ou de canard, le colis du natif de la région lyonnaise contenait de la rosette ou du saucisson brioché, celui du franc-comtois était rempli de saucisses de Morteau ou de Montbéliard, celui du marseillais contenait un bocal de bouillabaisse etc. etc. si bien que le front devint le lieu de convergence et de découverte de toutes les richesses gastronomiques de la France.
Le ravitaillement des civils
Les populations civiles connurent des sorts différents selon qu’elles vivaient en zone occupée ou en zone libre à l’arrière du Front établi à l’automne 1914. Coupés du reste du pays, les habitants des zones occupées ne pouvaient recevoir aucune aide directe de la France et devaient se contenter de la part congrue que leur laissait l’armée allemande. Ils bénéficièrent en outre de l’aide alimentaire fournie par les USA et l’Espagne destinée en principe aux populations belges mais dont la distribution parvenait aussi aux Français sous occupation.
L’approvisionnement du reste du pays était de la responsabilité du Service du ravitaillement civil, créé au sein du ministère du commerce le 8 septembre 1914. Il se divisait en deux sections : l’une chargée « du ravitaillement en grains, farines et fourrages » et l’autre « du ravitaillement en toutes autres denrées et marchandises». Il avait pour mission d’assurer le ravitaillement de la population civile en facilitant l’importation et la répartition des denrées essentielles à son alimentation. En décembre 1916, fut créé le ministère des Travaux publics, des Transports et du Ravitaillement, qui prit le relais du Service du ravitaillement pour tout ce qui concerne l’application des lois et les règlements concernant le ravitaillement des populations civiles, la taxation et la réquisition des denrées de subsistance. Puis ce ministère changea de nouveau de nom et de périmètre en 1917.
Se nourrir en pays occupé
La zone occupée était divisée en deux parties : une première dite « zone des armées » qui s’étendait vers le nord et l’est sur une largeur de 75 kilomètres à partir de la ligne de front et qui se distinguait de la zone dite « d’occupation », qui couvrait le reste du territoire français et une partie de la Belgique. La zone d’occupation était soumise à un régime plus souple que la zone des armées, laquelle se divisait en deux parties : une zone dite « des opérations » située immédiatement à côté de la ligne de Front, soumise à la loi martiale, et une zone dite « des étapes » qui lui faisait suite. Si le contrôle policier était plus strict dans la zone de guerre, il n’était pas plus aisé de se procurer de la nourriture dans la zone d’occupation tant les Allemands s’attribuaient la part essentielle des denrées alimentaires disponibles.
Les habitants de l’ensemble des zones contrôlées par l’occupant connaissent des conditions de vie très dures. Maurice Delmotte, brasseur et cultivateur à Fontaine-au-Pire, un village situé en zone des étapes donna en quelques lignes la mesure de ce que lui et ses compagnons d’infortune des vécurent durant ce conflit : « Il faut livrer des œufs sans grain [pour nourrir les poules], même ceux à qui il manque des poules ; livrer des noix, alors qu’ils ont abattu les noyers, coucher douillettement les officiers, alors qu’ils ont pris les matelas ; balayer les rues… et on vous réquisitionne les balais !». Devant vivre sur les ressources du territoire, l’armée d’occupation n’hésitait pas à recourir à l’arbitraire, voire au vol caractérisé pour s’emparer des biens des habitants des zones qu’elle contrôlait.
Les Allemands mirent la main sur les récoltes faites avant l’invasion et prirent les mesures nécessaires pour s’assurer celles à venir. Sur la base des estimations approximatives qu’ils établirent, ils ordonnèrent la réquisition des cinq sixièmes des récoltes, et punissaient sévèrement ceux qui osaient s’affranchir de leurs règles. De fait, personne n’osa garder le moindre grain pour sa consommation, alors même que la ration par semaine ne dépassait pas 2 840 grammes de pain par personne. L’occupant ne se borna pas à rafler les céréales ; il réquisitionna tous les produits alimentaires, à commencer par les animaux de boucherie, les animaux de basse-cour, les œufs, le beurre, les légumes du potager etc. Rien ne devait échapper aux autorités allemandes ou françaises lorsque celles-ci étaient restées en place et s’étaient engagées à appliquer la loi de l’occupant. Les Allemands imposèrent aussi un rationnement qui variait d’une ville à l’autre mais qui était drastique dans tous les cas. A Fourmies, par exemple, les habitants avaient droit à 108 grammes de farine par jour et par adulte, quantité complétée de 60 grammes de pain par enfant pour les familles.
La razzia organisée et méthodique de l’occupant produisit une constante pénurie alimentaire et, dans certains cas extrêmes, de véritables disettes plus ou moins prolongées. Maintenus dans un état de sous- alimentation chronique, de nombreux habitants de la France occupée ne parvenaient à survivre que grâce à l’aide alimentaire des USA et de l’Espagne, dont l’action humanitaire passait par la Commission for Relief in Belgium. Cette aide était tolérée par les Allemands dans la mesure où elle contribuait à maintenir la paix sociale et, surtout, parce que l’occupant détournait une bonne partie de cette aide à son profit. Après l’entrée en guerre des Américains aux côtés des Alliés, les Pays Bas prirent leur place aux côtés de l’Espagne pour maintenir cette aide alimentaire indispensable aux habitants des zones occupées.
Se nourrir à l’arrière du Front
La situation des civils français vivant à l’arrière du Front était bien différente, même s’il faut nuancer le tableau de la « France libre ». Il y avait une grande différence entre la vie de taupinière des rescapés des bombardements des villes et villages situés dans les zones de combat, et celle des habitants du reste de la France. À Reims, Soissons, Béthune, Arras, Péronne, et d’autres agglomérations plus ou moins importantes soumises au feu permanent de l’ennemi, les rares habitants présents vivaient tapis dans des caves ou dans des maisons à moitié détruites, alors que dans les villes et villages de l’arrière, les habitants pouvaient vaquer à leurs occupations, sortir dans les rues, s’attarder aux terrasses des cafés, se déplacer tranquillement en autobus, vélo, jouir de leur foyer, manger à table, dormir dans leur lit…
À la campagne
La guerre creusa aussi le fossé entre les modes de vie urbain et rural. Rien de comparable en effet entre le quotidien d’un citadin, même modeste ouvrier ou employé, qui disposait des commodités de la ville, et celui d’une paysanne, en charge de son foyer, dont l’horizon ne dépassait pas le périmètre de la ferme. Avec les travaux des champs que la fermière devait désormais assumer seule et qui s’ajoutaient aux activités ménagères, les journées de labeur étaient longues, exténuantes et laissaient très peu de place aux moments de détente.
La vie rurale présentait néanmoins certains avantages sur la vie urbaine. Pouvant compter sur les ressources de la ferme, du jardin et de la basse-cour, les paysans étaient moins tributaires des pénuries alimentaires que les ouvriers et les petits employés des villes. De même, l’augmentation des prix des produits alimentaires avait moins d’impact sur leur quotidien que sur celui des classes populaires urbaines qui devaient tout acheter, du pain aux légumes, du sel au lard ou à l’huile. Les paysans faisaient généralement leur pain, cultivaient leurs légumes et le saloir suffisait bien souvent à leur fournir la viande dont ils avaient besoin pour enrichir leur soupe quotidienne, qui restait, sous ses différentes formes régionales, le plat le plus répandu dans les campagnes françaises.
À la ville
La situation était différente dans les villes de l’arrière du front, où la raréfaction des denrées alimentaires entraînait automatiquement l’augmentation des prix des produits disponibles. Pénurie et inflation étaient les grandes questions qui se posaient aux autorités gouvernementales et municipales. Déjà forte en1915, l’inflation prit des proportions alarmantes à partir de 1917 et poursuivit sa trajectoire jusqu’en 1920. Elle connut un sérieux coup d’accélérateur notamment après le lancement par les Allemands de la guerre sous-marine, qui porta des coups très durs au ravitaillement de la France. Et les premiers à en pâtir ce furent naturellement les populations civiles des zones non prioritaires. Les prix de certains produits et denrées alimentaires furent multipliés par 3, par 5, par 7 voire par dix par rapport à la période d’avant-guerre. Les réquisitions de l’armée et les difficultés de transport firent de la viande et du poisson frais des produits rares et chers, hors de portée de la bourse des plus modestes.
Dans les villes, la lutte contre l’inflation passa par la création de magasins municipaux qui vendaient à prix coutant les denrées de première nécessité. A cet égard, la municipalité de Bordeaux, joua un rôle pionnier, mais Paris, Lyon, et bien d’autres villes du pays suivirent son exemple. Le prix du pain était notamment l’objet de la plus grande attention tant de la part des municipalités que du gouvernement. Mais les mesures prises n’empêchent pas des tensions ici ou là. C’est le cas à Saint -Etienne où le pain vint à manquer dans les quartiers populaires, ou en Corse qui était tributaire de la France continentale pour son approvisionnement alimentaire.
À Paris
Paris bénéficiait d’un statut particulier qui distinguait la capitale de toutes les autres villes du pays. Le gouvernement considéra le ravitaillement alimentaire des Parisiens comme un enjeu stratégique de la guerre à l’égal du ravitaillement des combattants et en confia la gestion à l’armée. Mais, ces mesures exceptionnelles qui plaçaient Paris en zone prioritaire ne suffirent pas à assurer à l’ensemble des Parisiens un bon approvisionnement alimentaire, notamment au début du conflit. Dans l’esprit des stratèges militaires, il était entendu que Paris devait disposer de réserves de nourriture suffisantes dans tous les cas de figure, mais la réalité mit à mal ces bonnes dispositions théoriques. La panique qui gagna les responsables civils et militaires devant l’avancée des troupes ennemies, poussa l’intendance à concentrer tous ses efforts sur le ravitaillement des troupes. Dès l’entrée en guerre, Paris ne disposait que de dix jours de réserves de vivres, ce qui plaça la ville dans une situation très précaire.
La pénurie eut un effet sur les prix des denrées alimentaires, dont l’augmentation provoqua des tensions dans les quartiers populaires. Les ouvriers, qui étaient d’ailleurs en majorité des ouvrières, vivaient difficilement de leurs maigres salaires. Leur vie se déroulait entre leur logement exigu, souvent insalubre, et l’usine, qui était située généralement en banlieue, au mieux dans une commune limitrophe de la capitale. Le trajet entre le domicile et le lieu d’activité nécessitait souvent des heures de transport au petit matin et en fin d’après-midi, ce qui rallongeait d’autant la journée de travail. Au retour, l’ouvrière devait en prime prendre place dans les queues interminables devant les magasins d’alimentation et, le plus souvent, lorsque son tour arrivait, il n’y avait plus grand-chose à vendre. Pour beaucoup d’entre elles, manger, nourrir leur famille était un casse-tête quotidien car elles ne pouvaient ni compter sur le potager comme les paysans, ni accéder aux circuits parallèles et au marché noir dont les prix pratiqués étaient hors de portée de leur bourse.
Rationnement
Dès avril 1916, le gouvernement établit un prix maximum sur la viande congelée. En mai, la mesure fut étendue au sucre, puis vint le tour des pommes de terre, celui du lait et du beurre. Mais ni ces restrictions imposées par le gouvernement, ni les mesures prises par les municipalités ne suffirent à juguler l’inflation après le déclenchement de la guerre sous-marine en 1917 qui accentua la pénurie des produits alimentaires. Pour faire face à cette situation nouvelle, le gouvernement décida d’imposer un véritable rationnement. Les premières cartes de rationnement, distribuées dès janvier 1917, concernaient le sucre, puis ce fut au tour du pain dont la quantité était limitée à 500 grammes par jour pour les enfants de plus de 6 ans. À partir de février 1917, obligation fut faite aux pâtisseries de fermer deux jours par semaine. A la fin de l’année, il fut interdit de consommer les pâtisseries, pour éviter le « gaspillage » de la précieuse et trop rare farine de froment. Pour limiter la consommation des produits de luxe, les autorités réglementèrent même le contenu des repas servis dans les restaurants, ou chez les traiteurs.
Dès janvier 1917 il fut interdit de servir plus de deux plats pour un repas, lequel ne devait t comporter qu’un seul plat de viande et aucun entremet ou dessert contenant de la farine, du lait, des œufs et du sucre. En avril de la même année, il fut instauré le dîner sans viande. En décembre 1917, la ration de pain fut abaissée à 200 grammes pour les repas ordinaires et à 100 grammes pour les repas de fête. Plus tard, le gouvernement imposa la fermeture des boucheries deux jours par semaine, puis trois jours à partir de 1918. La dernière année de guerre fut inaugurée par un autre train de mesures visant à limiter, sinon interdire la consommation des produits de base. A partir de février 1918, le beurre ne devait être utilisé que comme graisse de cuisine et la crème fut strictement rationnée tout comme le fromage frais et le sucre. Il fut interdit aux commerces de bouche de proposer tout aliment solide entre 9 et 11 heures le matin et entre 2 heures 30 et 6 heures 30 l’après-midi. Une carte d’alimentation individuelle unique fut imposée partout en France. Elle comportait six séries de coupons, dont deux réservées au pain et au sucre, et les quatre autres à des produits au choix.
Paradoxes de la Grande Guerre
Si personne ne mourut de faim en France, les populations civiles du pays, sous autorité allemande ou habitant à l’arrière du Front, durent à tout le moins se serrer la ceinture durant les dernières années de guerre. Paradoxalement ce ne fut pas le cas pour les millions de soldats appelés à défendre la patrie. La nourriture des poilus n’était certes pas de la meilleure facture, mais elle ne manqua que rarement sur le front et toujours pour un temps limité et dans des circonstances particulières. Les autorités gouvernementales veillèrent à assurer leur ravitaillement alimentaire en toute circonstance, quitte à sacrifier momentanément l’approvisionnement des populations de l’arrière.
L’effort de guerre consenti par la France fut gigantesque. D’autant que le pays avait cumulé des retards considérables dans des secteurs clés comme l’industrie alimentaire, les transports et le stock. Certes, la France put compter sur la Grande-Bretagne qui assura la protection des voies maritimes et lui fournit les navires équipés de moyens modernes pour le transport de denrées périssables. Les Britanniques organisaient aussi l’achat groupé des denrées alimentaires pour les alliés, ce qui stabilisa les prix sur le marché international.
Mais la France s’employa aussi à développer ses propres moyens. La guerre constitua en effet un prodigieux accélérateur du développement industriel et économique du pays. Stimulée par les commandes massives des armées, l’économie de guerre, à laquelle contribuèrent de manière décisive les femmes françaises, se développa rapidement dans tous les domaines. La production des armements connut un essor extraordinaire mais aussi l’industrie alimentaire. Des conserveries de poisson et de viande virent le jour pendant le conflit, de même que bon nombre de laiteries qui trouvèrent des débouchés à leurs produits sur le Front. Les transports, ferroviaires et routiers, connurent des améliorations considérables, ainsi que les moyens de conservation et de stockage des aliments.
Les soldats de la Grande Guerre furent, malgré eux, les pionniers pour la consommation de viande et de poissons en conserve, nourritures que les Français avaient boudé durant la période d’avant-guerre. Sur le Front, dans les tranchées, les poilus durent bon gré mal gré s’habituer à manger le corned-beef importé des USA ou les conserves de même nature de production nationale nommés « singe » par les poilus, pour signifier leur rejet. C’est aussi sur le front, en affrontant la mort au quotidien et en supportant les pires souffrances que beaucoup de soldats de la guerre de 14-18 goûtèrent pour la première fois un certain nombre d’aliments et de spécialités qui leur étaient inconnus. Bon nombre de soldats bretons, chtimis, picards ou normands d’origine paysanne burent pour la première fois du vin. Les mêmes soldats originaires de l’Ouest ou du Nord, n’avaient jamais eu l’occasion de goûter du confit d’oie ou de canard, du gruyère, du cantal ou du comté avant d’être mobilisés. Les soldats originaires d’autres régions découvrirent le camembert dont les achats massifs de l’intendance assurèrent le succès national après-guerre. Appelés à défendre leur pays, les soldats de la Grande Guerre découvrirent sur le front les richesses gastronomiques de la France et les survivants de cette épouvantable hécatombe d’en garder, malgré tout, la nostalgie.
En conclusion, l’Allemagne perdit semble-t-elle la guerre non en raison de la faiblesse de son armée mais parce que sa population civile était aux prises avec la disette ? La France, en revanche, ne connut jamais la situation extrême de son ennemi. Elle était ravitaillée par mer depuis ses colonies et ses alliés américains, canadiens, australiens et anglais qui contrôlaient les voies maritimes et imposaient un blocus à l’Allemagne. Ainsi, le ravitaillement alimentaire de la France fut dans l’ensemble satisfaisant, tant pour les combattants du front que pour les habitants de l’arrière.
Articles récents
Nos partenaires
Le Souvenir Français est la plus ancienne association mémorielle en France (création en 1887). Elle n’a qu’une ambition « servir la nation républicaine » en sauvegardant la mémoire nationale de la France. Afin d’atteindre cet objectif, Le Souvenir Français entretient des liens amicaux avec de nombreuses associations qui œuvrent en totalité ou partiellement afin de faire vivre […]
Voir l'article >Une photo et son histoire
Le monument du Souvenir Français d’Yvetot Monument du Souvenir Français à Yvetot. Situé dans la partie haute du cimetière Saint-Louis à Yvetot, en Normandie, le monument aux morts rend hommage aux soldats des armées de terre et de mer originaires des communes du canton d’Yvetot, tombés pour la Patrie. On peut y lire l’inscription : […]
Voir l'article >Journal du Président Général pour janvier 2026
Retrouvez dans cette rubrique les principales actions et déplacements du Président général du Souvenir Français pour le mois passé. Mercredi 7 janvier 2026 La commémoration du 95ème anniversaire des obsèques du Maréchal Joffre à Louveciennes (Yvelines) n’était pas banal. Présidé par le Préfet du département, cette cérémonie marquait la « victoire » juridique obtenue afin d’accéder à la […]
Voir l'article >